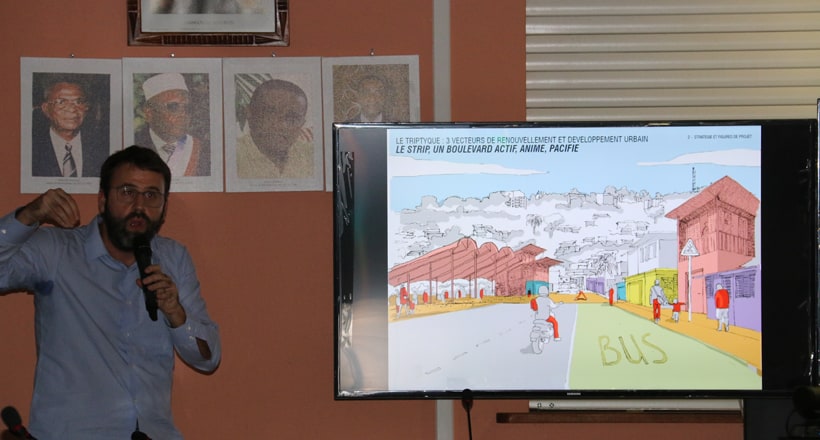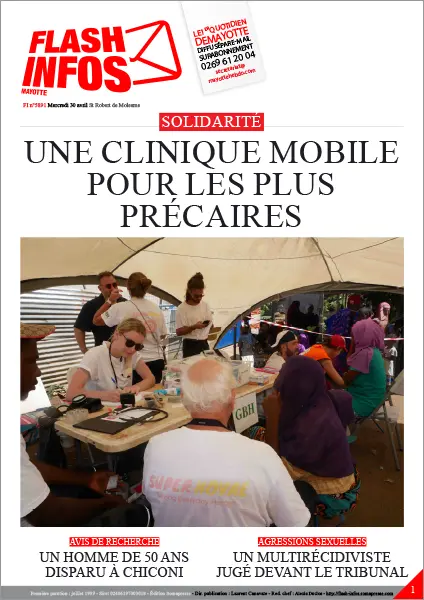Suite à la réunion du 10 octobre dernier entre l’intersyndicale, la conseillère de la ministre de la Santé (par visio-conférence), le directeur de l’ARS OI et la directrice du centre hospitalier, des agents ont décidé de se mettre de nouveau en grève le 2 novembre en attendant la réponse du gouvernement. Les grévistes insistent sur deux points par rapport à leurs revendications à savoir une prime mensuelle compensatoire de la suractivité à tous les agents pour une « reconnaissance réelle » de leurs efforts ainsi qu’une indexation de salaire à 53% minimum, à l’ensemble des employés exerçant à Mayotte, pour une égalité de traitement de salaire de tous les agents issus du même groupement hospitalier de territoire océan Indien (GHT OI). Retour en détail sur leurs revendications.
« Nous attendons du gouvernement Macron son investissement, ainsi que le déploiement des moyens financiers, humains et techniques pour les courts, moyens et longs termes.
« Prime mensuelle compensatoire de la surcharge de travail »
La prise en charge de la population par le système de santé à Mayotte se dégrade au fil des années. La situation professionnelle des personnels soignants est de moins en moins attractive. Tout cela semble dû à :
• Une augmentation de l’activité du CHM de 1,7% entre 2015 et 2016 et de 25% sur les trois dernières années (annexe rapport DIM),
• Un manque d’infrastructure, et de personnel (soignant, médical, paramédical, et technique),
• Le burnout, la saturation et l’épuisement considérables qui obligent les agents à multiplier les arrêts de travail),
• Les risques psychosociaux, avec des répercussions dans la vie familiale
• Absence des postes aménagés, non-existence des commissions,
• Une insécurité croissante dans tout le département,
• Un traitement partial du salaire entre les Centres Hospitaliers et le GHT (l’indexation des salaires est à 53% à la Réunion contre 40% pour Mayotte).
Ces phénomènes cités ci-dessus entrainent obligatoirement un déséquilibre dans le choix et la répartition des professionnels de santé entre Mayotte et la Réunion. Pour ces raisons nous demandons une prime mensuelle compensatoire liée à la surcharge d’activité, pour un montant de deux cents euros net pour tous les agents non-médicaux.
« La création d’une agence de santé autonome à Mayotte »
« Nul n’est mieux servi que par soi-même ». La création d’une agence de santé à Mayotte est plus que nécessaire pour résoudre les spécificités de notre département. Les médecins et le personnel hospitalier de Mayotte cherchent à alarmer les autorités sur la situation. Cependant, les problèmes ne semblent pas traités avec conviction. Plusieurs raisons nous amènent à penser que l’agence régionale de la santé est en faveur de la Réunion.
Voici quelques points illustrant nos propos :
• Le déficit du CHU Réunion a été imputé sur CH Mayotte, or nous effectuons les 90% de l’activité engendrée par les évasans, une convention existe entre la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte et le CHM, stipulant que tous les travaux des évasans doivent être effectués par le CHM.
• Un traitement inégalitaire du budget alloué pour l’Océan Indien : moins de 10% pour Mayotte contre plus de 90% pour la Réunion.
• L’annulation du « projet Bloc Opératoire », malgré sa nécessité et ses études déjà financées (500 000 €), pour une nouvelle construction d’hôpital à Saint-Paul (la réunion),
• Le non-respect du protocole d’accords signé au ministère de la santé en juin 2014, pour la mise en place d’un groupe de travail,
– L’absence des directeurs d’agence sur le territoire, est responsable d’un manque de réponses aux projets proposés,
• Une absence et exclusion totale des acteurs de santé de Mayotte dans les prises de décisions,
• Mayotte accueille le plus de « non assurés sociaux », nécessite la présence de spécialistes pour la prise en charge de pathologies rares et graves, est confrontée à un flux migratoire en constante augmentation. Pourtant les moyens accordés au maintien d’un GHT (Groupement Hospitalier des Territoires) favorisent la Réunion. L’hôpital de Mayotte manque d’institutions et d’infrastructures.
Afin de mettre en place des projets d’amélioration à Mayotte, les décisions doivent être prises localement. Il est difficile de prendre des décisions à distance, en étant éloigné de la situation, en ne prenant pas en compte les chiffres réels et les difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels de santé à Mayotte.
« Respect des accords et des engagements pris par le gouvernement «
Suite à deux mouvements de grèves en 2014, l’intersyndicale et le syndicat des praticiens du Centre hospitalier de Mayotte ont été reçus au ministère de la santé. Malgré la minimisation des difficultés auxquelles nous sommes confrontées au quotidien, des propositions temporaires ont été proposées par le directeur de cabinet (représentant du ministère).
• Un budget de 33 millions pour le recrutement d’urgence du personnel médical, soignant et paramédical (voir protocole juin 2014)
• L’augmentation des quotas des infirmiers, aides-soignants et auxiliaires puéricultrices,
• Un groupe de travail avec l’ensemble des partenaires sociaux, piloté par l’ARS,
• Une revoyure de ce protocole de juin 2014, prévu en 2017.
Nous constatons une mésestime totale de la part du gouvernement, de l’ARS et du CHM face à notre détermination pour la sauvegarde de la santé à Mayotte puisque rien n’a été suivi par la suite.
La formation, l’emploi et la préférence locale
Pour lutter contre le désert médical, et la sauvegarde et l’avenir de la santé à Mayotte, nous demandons la mise en application des dispositions réglementaires prévues par la circulaire du 23 juillet 2010, et des propositions déclinées dans le rapport du député Lebreton ainsi que dans le rapport du Préfet Bédier.
Voici une piste pour lutter contre le désert médical :
• L’application de la circulaire du 23 juillet 2010 relative à la mise en œuvre des mesures transversales retenues par le Conseil interministériel de l’Outre-mer pour favoriser, l’émergence d’une fonction publique plus représentative du bassin de vie qu’elle administre,
• L’application du rapport du préfet Bédier, rendu en avril 2012 et portant sur l’emploi des ultramarins dans la fonction publique,
• L’application du rapport du député Patrick Lebreton, remis le 4 décembre 2013 et comprenant 25 propositions dont la consécration des centres d’intérêts matériels et moraux comme « pivot du droit de la fonction publique applicable aux Outre-mer et aux Ultramarins » et l’instauration de « la prise en compte de la connaissance de l’environnement local dont la maîtrise de la langue pour les mutations».
Renforcement et structuration de l’offre de soins
L’augmentation et la répartition des patients par lieu d’habitation ne nous permettent plus de nous projeter uniquement sur la zone Mamoudzou.
Un nouveau Centre Hospitalier Universitaire doit voir le jour avec 22 salles de bloc opératoire dans les prochaines années au Centre de l’Ile. Plusieurs raisons nous obligent à réfléchir et à repartir l’offre de soins dans l’ile :
• 65% des patients viennent des périphériques contre 35% pour Mamoudzou,
• Les difficultés de circulation (centralisation des administrations et entreprises sur Mamoudzou),
• L’absence de transport en commun et sanitaire,
• Une forte immigration clandestine,
• Une obligation d’accès aux soins pour tout le monde,
• Absence de médecine de ville et de structure de soins privée.
Actuellement, les centres périphériques travaillent 24 heures sur 24. Les consultations sont ouvertes de 7h à 19h et une permanence de soin est assurée de 19h à 7h. L’augmentation de l’activité ces dernières années dans les périphéries, l’augmentation considérable de la population, l’absence de transports communs ainsi que le manque de spécialistes impose une réorganisation du système de soins.
Les centres périphériques de Dzoumogné, Kahani et de Mramadoudou doivent être dotés d’un bloc opératoire et doit être transformés en MCO (Médecine Chirurgie Gyn-Obstétrique).
• Médecine : 10 lits / Maternité : 30 lits,
• Urgences – UHCD : 8 lits, salle de déchoquage,
• Équipements d’un centre de radiologie standard.
Ces transformations nous permettraient de répondre à la demande de soins de la population en tenant compte des problématiques actuelles (immigration, circulation libre…). »
.jpg)














































.jpg)
.jpg)
.jpg)