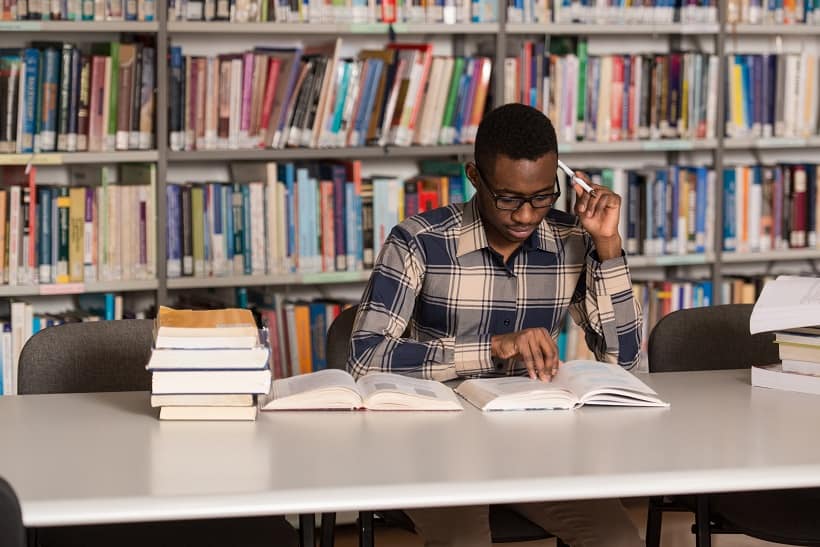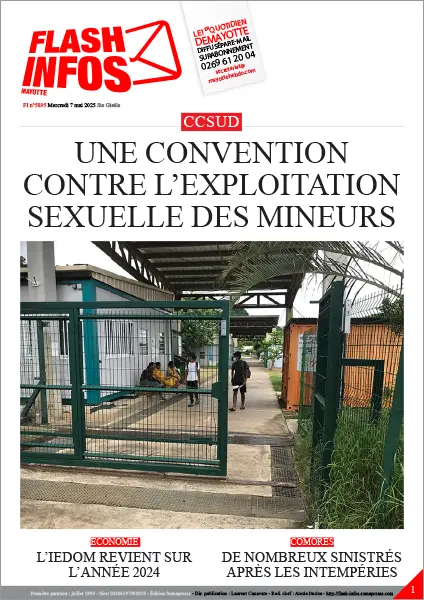L’avis spécifique des experts dédié aux Outre-mer dresse un tableau réaliste sur la situation particulièrement préoccupante de l’île aux parfums. Qui justifie une catégorisation à part, et des recommandations particulières.
Pour les Outre-mer, c’est un peu le calme avant la tempête. Du moins à en croire l’avis du conseil scientifique Covid-19 du 8 avril spécifique aux DOM-TOM. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a présenté les conclusions de ce rapport et les mesures associées lors d’une conférence de presse vendredi. Et si rue Oudinot, on se félicite sur l’efficacité de la stratégie adoptée depuis le 16 mars, en particulier la mise en place du confinement en même temps que la métropole, le ton est un peu plus prudent dans l’avis publié par les experts sous la houlette du professeur Jean-François Delfraissy.
“Cet avis nous conforte dans la stratégie et les mesures adoptées, en particulier le confinement, et ont déjà un impact positif en diminuant l’intensité de la propagation du virus dans les Outre-mer”, note ainsi Annick Girardin, rappelant aussi que “nous sommes à 141 hospitalisations pour l’ensemble des Outre-mer, soit quatre de moins qu’hier
[bilan établi en date du vendredi 10 avril, ndlr]”. Le premier point du rapport précise toutefois que “l’épidémie dans les territoires d’Outre-mer va s’aggraver dans les semaines qui viennent”. À noter que nos territoires ont trois à quatre semaines de décalage par rapport à l’Hexagone en ce qui concerne les débuts de l’épidémie.
Mayotte, catégorie à part
L’autre point de vigilance des experts ? C’est bien la situation de notre coin du monde : “Mayotte, le rapport en parle particulièrement en raison de ses fragilités sociales et de ses réalités sociétales”, constate également la ministre. À tel point que le rapport en fait une catégorie “à part”. La situation préoccupante de l’île aux parfums n’a donc pas échappé aux experts du conseil scientifique, qui relèvent des chiffres tristement connus : plus de 80 % de la population vit ici sous le seuil de pauvreté, 30 % des habitations n’ont pas l’eau courante et l’offre de soins est limitée. Rare avantage du territoire face au Coronavirus, la jeunesse de sa population, 50 % des habitants ayant moins de 18 ans et seulement 4 % plus de 70 ans. Mais l’information est “à tempérer par le fait que diabète et obésité, facteurs de risque de formes graves de Covid-19, touchent une partie importante de la population”. Sans compter que l’hyper-concentration du système de santé, et la méfiance d’une partie importante de la population envers l’administration, risquent de peser largement dans la gestion de la crise, voire d’engendrer un dépassement des capacités sanitaires “lorsque les quartiers pauvres de Mamoudzou, comme le bidonville de Kaweni, seront touchés”, décrivent aussi les experts.
Pour faire face à l’urgence, l’avis du conseil scientifique préconise d’abord la quatorzaine contrôlée pour tous les nouveaux arrivants, assortie de tests dépistages pour tous les voyageurs présentant des symptômes, et en fin de quatorzaine pour les voyageurs asymptomatiques. Il conseille aussi le suivi actif des personnes contacts et l’isolement des cas avérés en structure contrôlée extrahospitalière ; une telle structure doit justement ouvrir ses portes officiellement cette semaine, à l’internat de Tsararano. Enfin, la situation sanitaire particulièrement difficile pour les plus précaires justifie le recours à la gratuité d’accès à l’eau et la mise en place d’un circuit d’aide alimentaire, d’après l’avis du 8 avril. Deux derniers points sur lesquels a justement travaillé la préfecture, salue Annick Girardin, tout en appelant à “renforcer nos efforts”.
Un ratio lit/habitants à prendre avec des pincettes
D’une manière générale, les experts ont établi une liste de dix recommandations valables pour l’ensemble des Outre-mer. On y retrouve la poursuite du confinement strict, la mise en place de la quatorzaine préventive, l’intensification des mesures d’aide alimentaire, le suivi des cas contacts, la bonne disponibilité des masques, des équipements de protection individuelle et des solutions hydroalcooliques, mais aussi, le doublement de la capacité d’accueil en lits de réanimation, et les renforts des équipes sanitaires. Sur ces sujets aussi, la ministre Annick Girardin s’est voulue rassurante, en confirmant l’arrivée de 28 personnes issues de la réserve sanitaire pour Mayotte, et le passage de 16 lits de réanimation en capacité initiale à 50 lits aujourd’hui, “pouvant encore augmenter en fonction des renforts”, a-t-elle ajouté sans donner de détails. “Au niveau national, il est prévu un lit pour 5.400 habitants, et nous avons le même ratio pour les Outre-mer”, a-t-elle évoqué. Un ratio, valable pour Mayotte, certes, à condition de prendre en compte la population officielle de 270.000 habitants ; mais avec des estimations officieuses qui oscillent plutôt entre 350.000 et 400.000 habitants, le ratio s’établirait davantage autour de 1 lit pour 7.000 à 8.000 habitants…