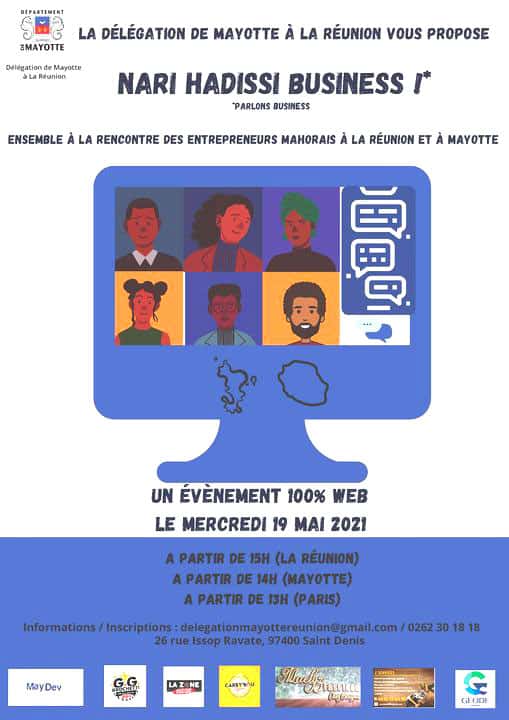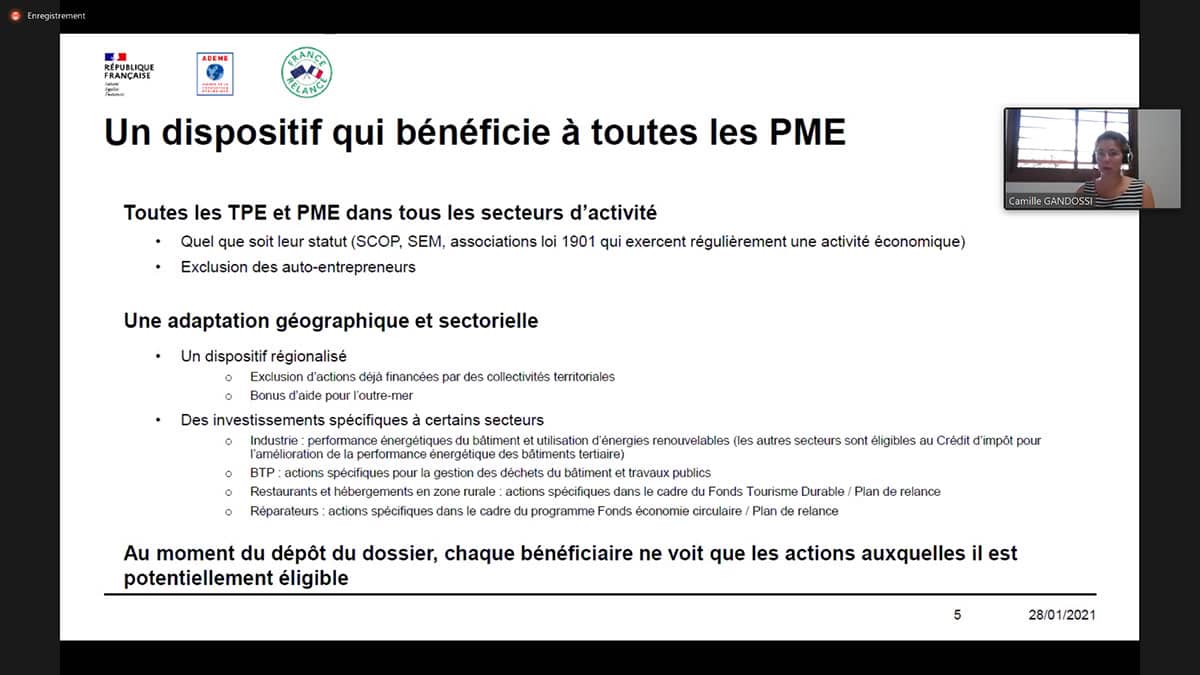Un conseil académique de la vie lycéenne s’est tenu ce mercredi après-midi au lycée des Lumières. Le recteur et son équipe sont partis à la rencontre des élèves élus des établissements scolaires pour échanger avec eux, écouter leurs doléances et leurs propositions.
Chaque année, environ trois conseils académiques de la vie lycéenne se tiennent pendant l’année scolaire. Si tous les sujets peuvent être abordés, cette dernière séance a été une nouvelle occasion d’évoquer les questions de violence. Dans un premier temps, les élèves ont fait part de leur quotidien au sein de leurs établissements respectifs. Face à eux, le recteur Gilles Halbout, la déléguée académique à la vie lycéenne, et le conseiller technique établissement et vie scolaire du rectorat. Après des échanges autour de l’insécurité, l’égalité fille/garçon, ou encore le rôle des EMS (équipes mobiles de sécurité), des propositions sont soumises par les élèves élus au conseil académique de la vie lycéenne de leurs lycées.
Formation des élèves pairs
L’un des sujets sur la table ? Le rôle des élèves pairs, ces jeunes formés par la gendarmerie pour repérer les situations critiques. En deux séances, une théorique et une pratique, ils sont mis en situation. « Le rôle de l’élève pair est d’être en lien avec ses camarades. Nous ne sommes pas des minis policiers, nous devons juste observer ce qu’il se passe à l’école et alerter quand il y a un problème », précise l’une d’entre eux. Sensibilisés sur les questions de violence et de harcèlement, ces observateurs doivent s’impliquer bien au-delà des frontières de l’établissement scolaire, puisqu’on leur de-mande de rester attentif à ce qu’il se passe dans les quartiers. Le but : repérer les potentiels règlements de compte. Une mécanique déjà bien huilée, avec un groupe WhatsApp, qui mêle forces de l’ordre et élèves pairs. En cas de problème, ces derniers peuvent envoyer un message pour alerter directement les policiers.
Renforcer l’implication des parents
La question de la parentalité a longuement été évoquée lors de cette séance. Les élèves n’ont pas hésité à pointer du doigt leurs géniteurs, trop peu disponibles. « Souvent quand il y a des réunions parents/profs, la moitié des parents ne viennent pas », soulève une lycéenne. Les raisons sont multiples, manque de temps, barrière de la langue, aucun moyen de se déplacer… C’est la raison pour laquelle une élève a proposé de mettre des bus à disposition des parents, par exemple. Une solution qui les incitera peut-être à s’impliquer davantage dans l’éducation de leurs enfants.
Lettre au ministre des Outre-mer
Autre point clé : les lieux de rassemblements. L’équipe du rectorat, tout comme les élèves, n’ont pas manqué de relever le manque d’espaces communs et publics en dehors des établissements scolaires. « L’idée serait de créer des endroits où les adultes et les enfants pourraient se retrouver pour échanger », indique la déléguée académique à la vie lycéenne. « C’est bien de créer ces endroits mais encore faudrait-il les sécuriser », rétorque un élève. D’autres n’y croient tout bonnement plus, à force d’entendre le même discours. « Depuis que je suis petite on réclame ça à Mirereni et on n’a rien. C’est ce qui favorise la délinquance, parce que quand on n’a rien à faire, certains se tournent vers la violence. À chaque élection, les candidats nous promettent un stade et nous n’avons toujours rien », tempête Souraya Souffou, la représentante du lycée de Kahani.
Création d’une vidéo contre la violence
Pour trouver un écho salvateur, les lycéens ont aussi lancé un projet de vidéo. Le petit film s’intitule « stop à la violence » et il a été initié par les élèves élus au Conseil national de la vie lycéenne qui sont à Mayotte. « On a parlé de notre situation à Mayotte au sein du CNVL et les autres étaient choqués. Ils ont tout de suite voulu nous épauler et ont envoyé des vidéos de soutien », explique Sarah Adam, déléguée de l’académie de Mayotte. Les élèves qui ont participé sont originaire de la métro-pole mais également de l’Outre-mer. Une fois finie, elle sera publiée sur le site du rectorat et sur ceux des autres académies qui souhaitent la partager afin de rendre plus visible la situation de l’île aux parfums.
Des collations qui posent problème
Le sujet de la collation a aussi été évoqué. Les élèves se sont plaints des sandwichs qu’on leur donne. « Il y a des aliments non identifiés », grimace une élève. L’équipe pédagogique rappelle tout de même que malgré les critiques, des nutritionnistes sont là pour composer ces collations. « Il faut trouver une bonne alternative entre les aliments bons et pas chers pour les familles », propose la dé-léguée académique à la vie lycéenne. D’autres aimeraient bien que les mamans puissent venir préparer les repas dans les établissements. Toute solution est bonne à prendre pour éviter que les élèves quittent les lycées pendant les heures de pause pour acheter à manger. « C’est durant ces moments là qu’on se fait agresser et que les bagarres éclatent », évoque Souraya Souffou, représentante du lycée de Kahani.
Autant de propositions et d’échanges qui sont appréciés par les élèves. « Cela nous aidera à trouver des solutions contre la violence », espère l’élève du centre. « Grâce à cette réunion, on a pu discuter avec les élus des autres lycées et c’est une bonne chose parce que c’est rare qu’on puisse se réunir et parler des problèmes de nos lycées », ajoute Nahed Issilamou, élu au CNVL. Les adolescents ont l’impression d’avoir été entendus, et repartent la tête pleine d’espoir. Le recteur et ses collaborateurs ne sont pas en reste. En quittant la séance, Gilles Halbout tient entre ses mains un carnet noirci par les propositions qui ont émergé de tous ces cerveaux à instruire. « Je retiens pas mal de bonnes idées… Il faut qu’ils échangent entre eux parce qu’il n’y a pas de solutions miracles. Il y a des propositions auxquelles on avait déjà pensé, d’autres qu’on va mettre en place », déroule le recteur de Mayotte. Action, réaction ! L’année scolaire s’achève dans quelques semaines. Gageons que ces idées seront bénéfiques, si ce n’est tout de suite, au moins aux lycéens de l’année prochaine.