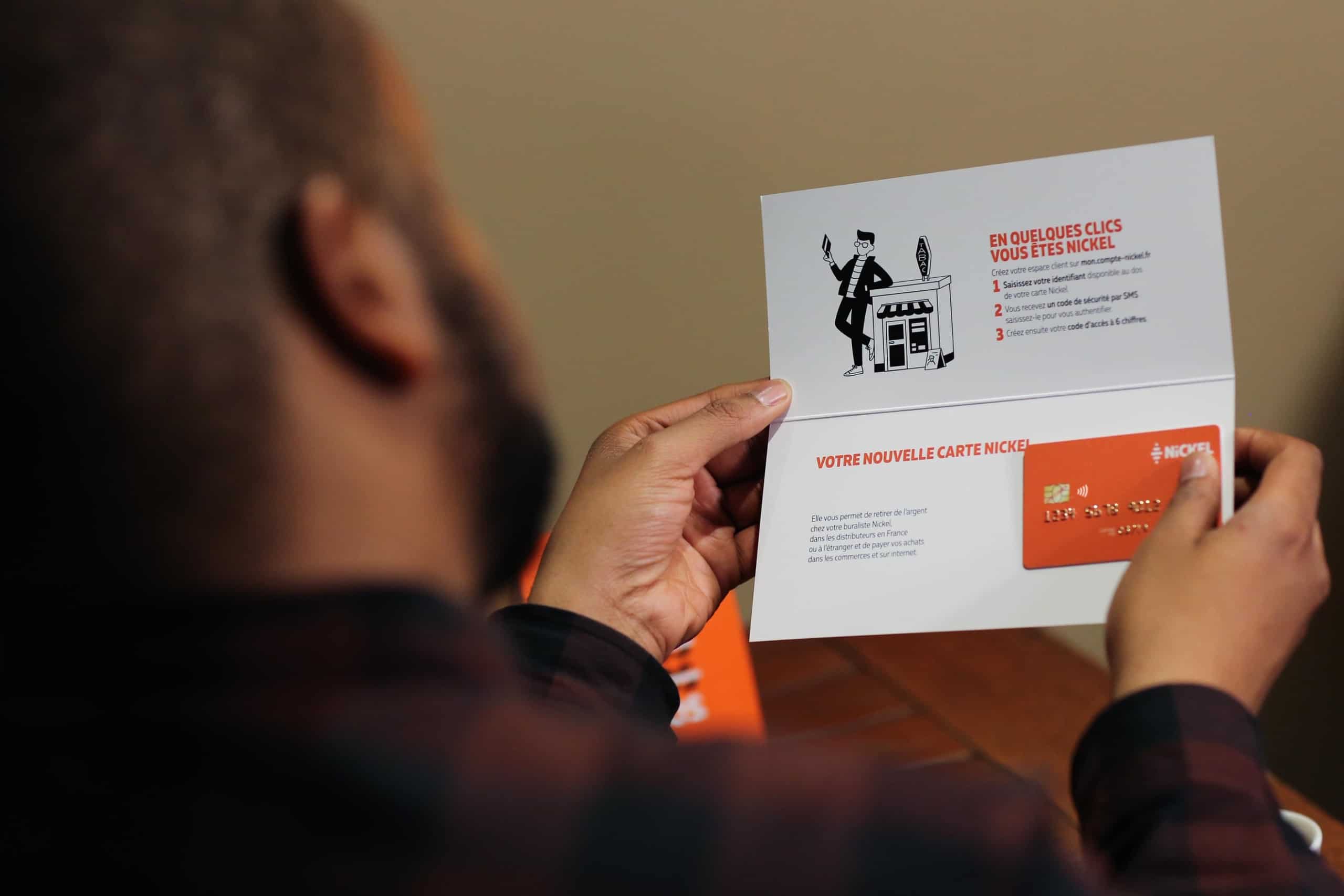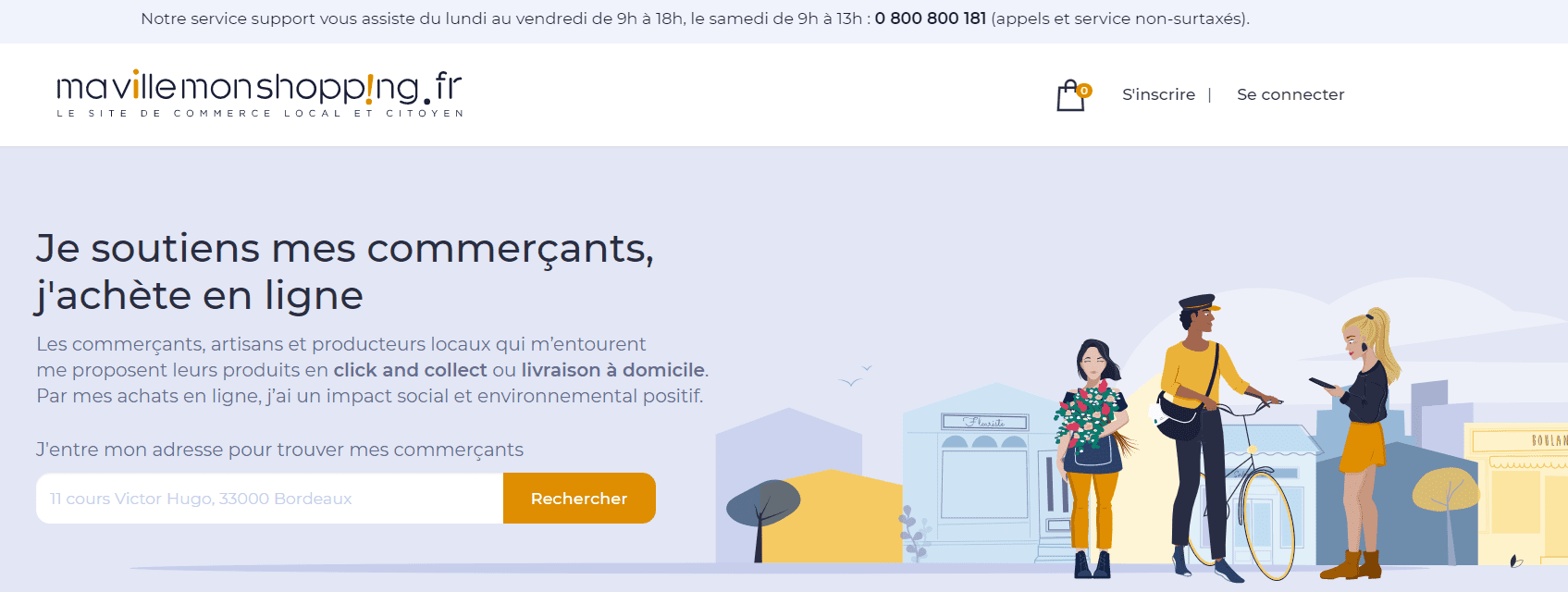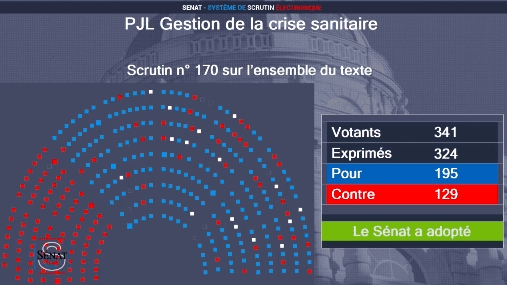L’allaitement maternel a toujours fait partie des coutumes à Mayotte. Un geste naturel que les mères mahoraises accomplissaient sans se poser de questions. De nos jours, la mondialisation a relégué le lait maternel au second plan, au profit du lait artificiel. Pourtant, l’allaitement maternel est un allié incontournable pour le bébé et la mère. Les professionnels se démènent pour informer les familles, particulièrement durant la semaine mondiale de l’allaitement, du 2 au 6 août. Le réseau périnatal de Mayotte s’est déplacé dans différentes villes du territoire pour mener une campagne de sensibilisation. L’occasion de rappeler l’importance du lait maternel avec le président du Répéma, le docteur Soumeth Abasse, également pédiatre au CHM.
Flash Infos : Quels retours avez-vous eu des mères qui vous ont approchés durant la semaine mondiale de l’allaitement ?
Soumeth Abasse : C’est la première fois que le Répéma se mobilise pour une campagne directement ciblée à la population. Les autres années, nous faisions des formations destinées aux professionnels, tels que les infirmiers, les auxiliaires de puériculture, certains médecins. Nous avons mené des actions sur le terrain, nous avons mis des affiches un peu partout. Nous avons l’impression que tout cela a été utile, parce que nous avons des mamans qui ont été surprises par certains messages positifs sur le lait maternel.
FI : Quels sont les bienfaits du lait maternel pour un bébé ?
S. A. : Ils sont nombreux ! Le lait maternel est un aliment de qualité et complet pour le bébé. Il est nourrissant, nous n’avons pas besoin de le compléter avec d’autres aliments. En plus de cela, il est personnalisé pour chaque enfant. Nous voudrions casser le cliché qui dit que le lait maternel est destiné aux familles défavorisées. Certains pensent que lorsque l’on nourrit son enfant avec le lait maternel, c’est parce que nous n’avons pas les moyens d’acheter le lait artificiel… Nous devons arrêter de penser ainsi. Le lait maternel protège le bébé des infections. Cela ne veut pas dire qu’il ne tombera jamais malade, mais cela réduit la dangerosité de ces infections. Un bébé nourrit exclusivement au lait maternel est moins hospitalisé.
Il y aussi un autre aspect non négligeable. Quand on allaite, la mère et le bébé sécrètent de l’ocytocine, plus communément appelé l’hormone de l’amour. Cela permet de renforcer ce lien entre les deux, et c’est très important pour le développement de l’enfant. Il y a aussi des études qui montrent que le lait maternel participe largement au développement intellectuel du bébé. L’organisation mondiale de la santé (OMS) recommande fortement de nourrir son bébé exclusivement avec du lait maternel jusqu’à six mois. Plus l’allaitement maternel dure, plus l’enfant est protégé.
FI : Et qu’en est-il de la mère qui allaite ?
S. A. : Elle a tout à y gagner également. Après l’accouchement, l’utérus d’une mère qui allaite reprend sa place plus rapidement que celui d’une mère qui n’allaite pas. Nous savons aussi que l’allaitement permet aux mamans de perdre plus de poids. Et il réduit aussi les risques de cancer du sein.
FI : Combien de mères allaitent à Mayotte ?
S. A. : Nous savons qu’à la sortie de la maternité beaucoup de mamans allaitent. Le taux est autour de 80 à 90%. Le problème c’est que nous savons pas à six mois de vie du bébé, combien de mères continuent le lait maternel exclusif. Une enquête doit être publiée par santé publique France, mais pour l’instant, nous n’avons pas encore les données. Cela étant, je pense que le taux ne doit pas être très élevé parce que beaucoup font l’allaitement mixte.
FI : Le lait artificiel a pris beaucoup de place dans la société. Avez-vous l’impression que les mères sont assez sensibilisées sur les bienfaits du lait maternel ?
S. A. : Peut-être pas suffisamment. Dans nos traditions, les mamans étaient habituées à allaiter, c’était un geste naturel. Et de ce fait, nous ne nous sommes pas creusés la tête pour encourager l’allaitement. Parallèlement, les laboratoires ont mis pas mal d’énergie et de moyens pour promouvoir le lait artificiel. Dans les pays du tiers monde et même en Europe jusqu’aux années 90, le lait artificiel était la référence. Et maintenant, depuis environ 20 ans, onous encourageons beaucoup le lait maternel. Ce sont même les femmes issues d’un milieu aisé qui allaitent davantage.
Malheureusement sur notre île, souvent les mamans préfèrent un allaitement mixte alors qu’elles peuvent complètement allaiter leur bébé. Nous n’avons pas besoin de rajouter du lait artificiel à moins que la mère ne produise pas assez de lait, et même dans ce cas nous pouvons l’aider. Il ne faut pas que le code standard soit l’allaitement mixte. Les mères actives préfèrent le lait artificiel afin d’être plus libres, mais il existe le tire-lait. Les mamans peuvent tirer le lait et le garder au réfrigérateur, et ainsi avoir leur autonomie. Cet appareil est remboursé par la sécurité sociale jusqu’à six mois de vie du bébé. Donc je pense qu’il y a un certains nombre d’actions qu’il faudrait mettre en place pour valoriser le lait maternel.
FI : Le lait artificiel a longtemps été plébiscité, et depuis une dizaine d’années la tendance tend vers un retour au lait maternel. Pour quelles raisons ?
S. A. : Le lait artificiel n’est pas mauvais, sa fabrication doit respecter des règles très strictes. Le problème c’est qu’il s’agit de lait de vache qui a été modifié pour ressembler le plus possible au lait maternel. Beaucoup de soignants sont un peu frustrés, parce que nous faisons beaucoup de publicité pour le lait artificiel alors qu’il n’y en n’a pas assez pour le lait maternel.
FI : Une mère atteinte de la Covid-19 peut-elle allaiter son bébé ?
S. A. : Au départ, en Chine ils avaient interdit le lait maternel pour les mères infectées en pensant qu’il y avait un risque pour le bébé. Maintenant, nous avons assez de recul pour savoir qu’il y a plus de risques à ne pas allaiter son bébé. La mère peut mettre son masque et allaiter le bébé tout en prenant ses précautions d’hygiène. En plus, les anticorps de la mère passent à travers le lait maternel et renforcent l’immunité du bébé.