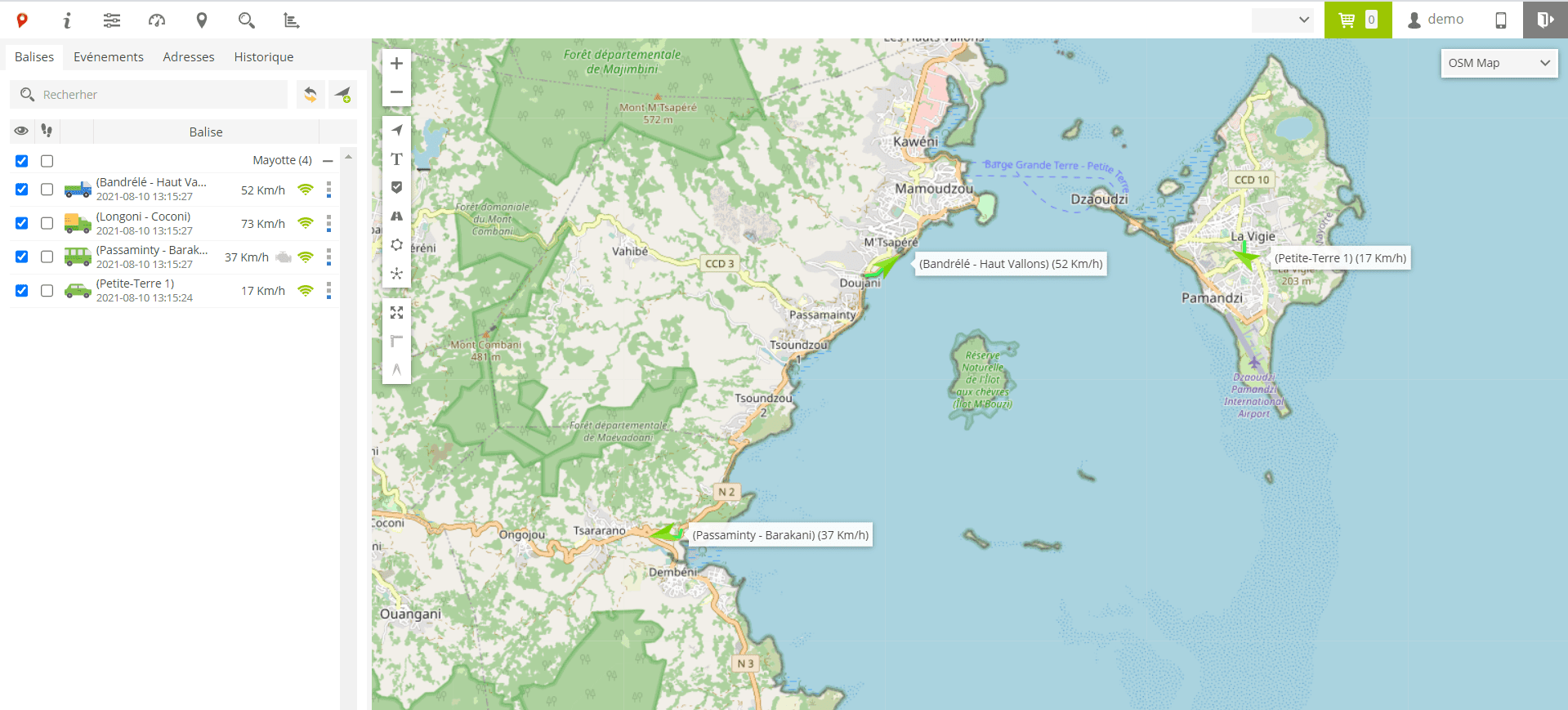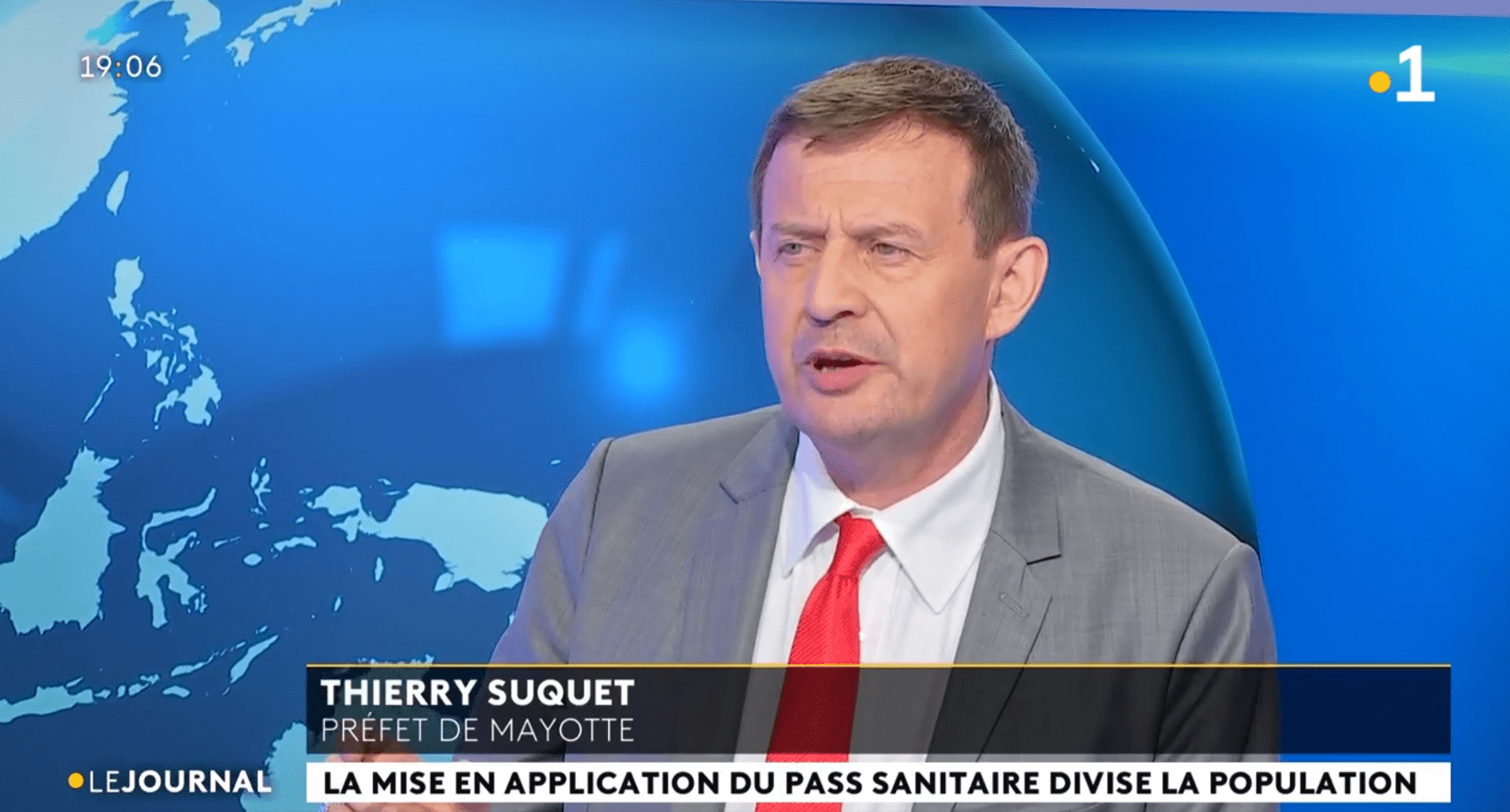La réouverture des frontières avec l’archipel voisin le 9 juillet dernier a provoqué un mouvement de foule après des mois de blocage lié à la crise sanitaire. Problème : dans l’autre sens, la préfecture impose un nombre restreint de passagers, tant pour la compagnie maritime SGTM que pour Ewa Air et AB Aviation.
Ça bouchonne de l’autre côté du bras de mer ! Alors que les élèves et le personnel de l’académie sont censés reprendre le chemin de l’école en début de semaine prochaine, plusieurs témoignages font état d’une situation problématique : des voyageurs mahorais venus profiter de l’ouverture des frontières et des vacances pour se rendre aux Comores voisines se sont vus refuser l’embarquement et se retrouvent le bec dans l’eau, sans date de retour. Ismaël*, un transporteur de Mayotte, devait ainsi s’envoler avec sa fille mercredi dernier. Depuis, il est toujours en attente d’une solution. “AB Aviation ne nous a donné aucune réponse, ni prise en charge”, raconte-t-il sous couvert d’anonymat. “Quand on s’est présenté à l’aéroport, l’armée nous a dégagés comme des malpropres, sur les ordres d’AB. C’est inadmissible ce qui se passe ici…”
Même son de cloche pour Kassim* qui devait pourtant retourner au travail dès le 9 août. “Déjà quand je suis allé à Maria Galanta à Mayotte, je voulais prendre un aller simple, et on m’a dit que je devais prendre un aller-retour, mais sans date de retour !”, retrace ce médecin avec consternation. S’il parvient à embarquer finalement à bord du navire, c’est dans le sens Anjouan-Mayotte que les choses se corsent. “Je vais pour acheter le billet retour, et on me dit ‘‘non, il y a un quota, vous ne pouvez pas rentrer avant le 28 septembre’’. Mais moi je suis médecin, j’ai des consultations !”, s’insurge ce voyageur qui est même revenu à la charge avec une attestation de son employeur, sans succès. Sa fille, venue de France, avec un passage par Mayotte, aura dû débourser quelque 700 euros de frais pour changer son billet et rentrer à Toulouse, via Moroni…
230 places par semaine seulement
Mais que sont ces fameux quotas ? En réalité, les compagnies maritimes et aériennes ne sont pas vraiment responsables de cet imbroglio. Et si elle est quelque peu passée sous les radars, l’information a bel et bien été transmise via le compte Facebook de la préfecture de Mayotte, notamment. Dans un post daté du 12 juillet, l’administration indique qu’il “est fortement recommandé aux voyageurs de se préoccuper de leur billet retour, les capacités de voyage vers Mayotte étant limitées (180 places par voie aérienne et 150 par voie maritime chaque semaine)”. Dans une interview accordée à nos confrères du Journal de Mayotte, le directeur de la compagnie maritime SGTM Maria-Galanta Michel Labourdère déconseillait d’ailleurs de saisir cette opportunité de la réouverture des frontières pour partir en vacances : “Actuellement il y a des quotas sur les retours, en aérien comme en maritime. (…) Comme ils ne sont pas certains de pouvoir revenir, on dit bien à nos passagers qu’il serait prudent de reporter le voyage”.
C’est là toute l’absurdité de la situation : car les bateaux et les avions sont bien partis chargés à bloc du port et du tarmac, dans le sens inverse. Dans la même interview, la compagnie vantait d’ailleurs les capacités de son nouveau catamaran, le Maria-Galanta Express qui, avec ses “400 places contre 200 pour les anciens”, permettait de diminuer les rotations, normalement de “2 à 3 bateaux par jour en haute saison”. Dès lors, l’on pouvait donc naturellement s’attendre à quelques embouteillages en retour de vacances !
Test antigénique à l’arrivée
La raison de ces mesures restrictives n’est pas non plus un secret : en effet, en plus de leur test PCR au départ, les passagers en provenance des Comores, vaccinés ou non, doivent passer sous le coton-tige (antigénique) à leur arrivée à l’aéroport ou à la gare maritime de Mayotte. Or, pour mener à bien cette stratégie, il est indispensable de pouvoir réguler les flux… “C’est une question de logistique pour l’agence régionale de santé (ARS), qui doit pouvoir mobiliser des infirmiers et du personnel”, confirme Ayub Ingar, le directeur général de la compagnie Ewa Air, elle-même limitée à deux vols par semaine sur rotation, comme AB Aviation. Si l’explication se tient, difficile d’imaginer les centaines de Mahorais laisser passer sans bruit la date de la rentrée. “Notre agence à Moroni est envahie, surtout depuis cette semaine”, confirme Ayub Ingar.
*les prénoms ont été modifiés