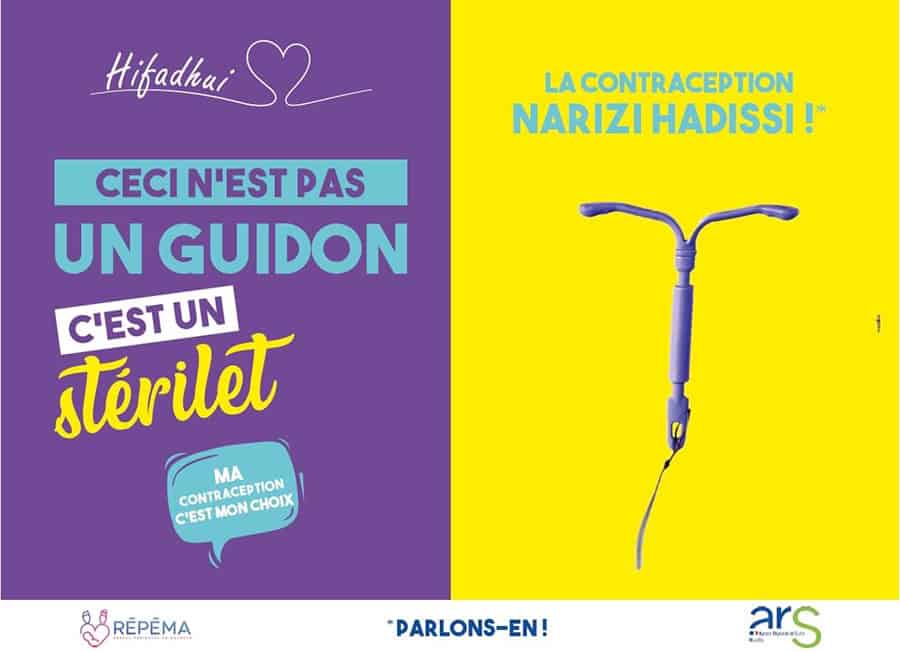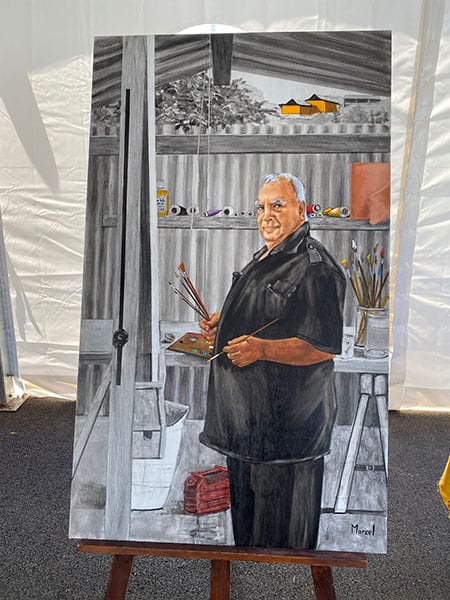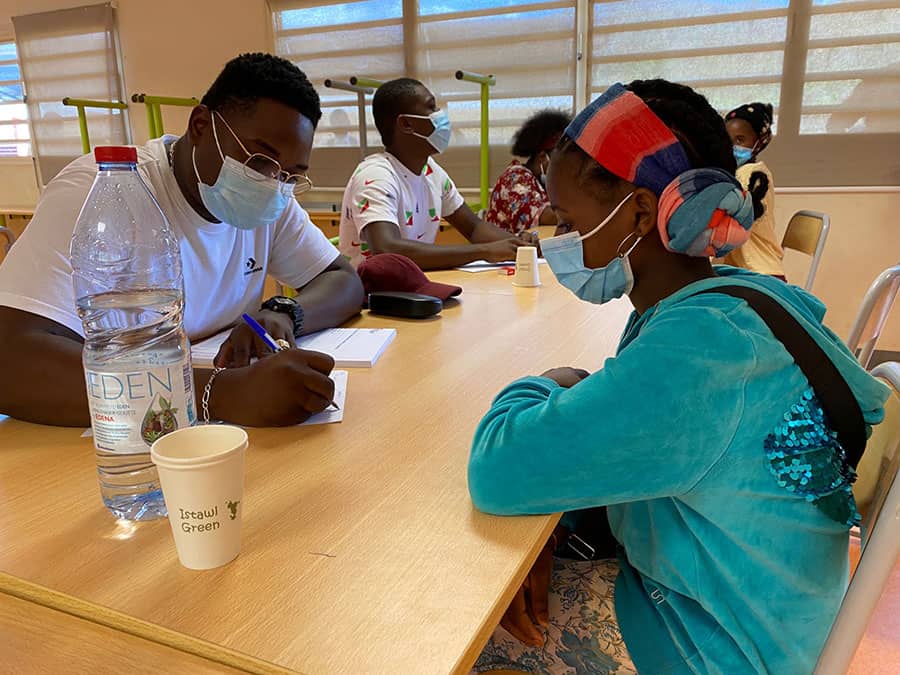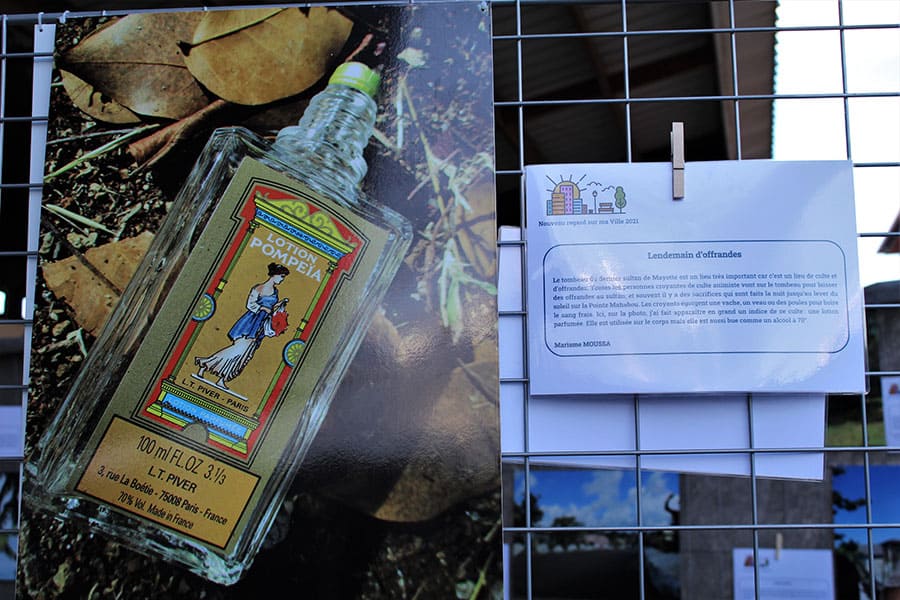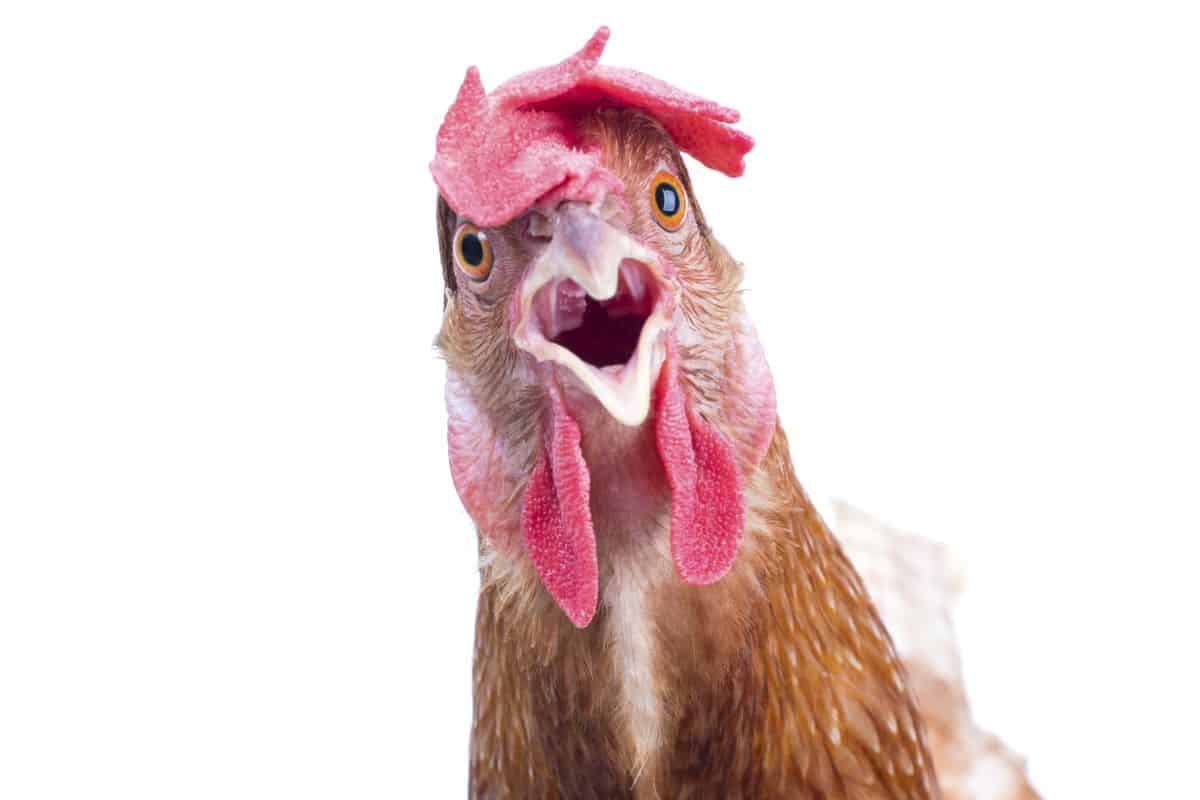Lundi 13 septembre, le député européen de La Réunion Stéphane Bijoux présentait devant le parlement de l’Union sont rapport intitulé « Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de l’Union ». Le lendemain, il était adopté à une très large majorité en séance plénière. Parmi les mesures phares du texte, le développement de l’activité agricole, afin de favoriser l’autonomie alimentaire des territoires concernés, et promouvoir le secteur auprès des nouvelles générations, tout en tenant compte des défis environnementaux qui s’imposent à elles.
Mayotte Hebdo : Pourquoi était-ce selon vous nécessaire de renforcer le partenariat entre l’Europe et ses régions ultrapériphériques ?
Stéphane Bijoux : À Mayotte comme dans tous les Outre-mer, les bouleversements d’aujourd’hui nous obligent à revoir nos priorités et nos modes d’actions. La stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques (RUP) doit impérativement intégrer les nouveaux défis et apporter des réponses concrètes aux urgences sanitaires, économiques, sociales et climatiques qui touchent nos populations. Avec mon rapport parlementaire, j’assume de vouloir envoyer un message politique fort : nous avons besoin et nous exigeons un nouveau plan d’actions pour nos territoires ultramarins.
C’est la première fois depuis 2019 que le Parlement européen fixe un cap politique pour les RUP et cet appel a été adopté à une très large majorité (avec plus de 600 voix « Pour« ). La nouvelle stratégie que je propose vise à placer les RUP, non pas en périphérie, mais au centre de l’action publique européenne. Pour cela, il faut généraliser un « réflexe Outre-mer » dans toutes les institutions de l’Union européenne : c’est à la fois une vigilance et une exigence de résultats qui doit irriguer toutes les politiques de l’UE.
MH : Qu’est-ce que cela pourrait concrètement changer pour les RUP ?
S. B. : Mon rapport est construit autour de trois priorités : consolider les acquis, respecter nos spécificités et ouvrir de nouveaux horizons.
Consolider les acquis : ça signifie protéger les outils qui rendent l’Europe concrète pour les Ultramarins, qui permettent de développer nos territoires, de construire des projets, de soutenir les secteurs économiques clés : le POSEI (programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insalubrité, ndlr) pour nos agriculteurs et éleveurs, le FEAMPA pour nos pêcheurs, le FSE pour les plus fragiles, Erasmus pour nos jeunes, ou encore le FEDER pour développer nos infrastructures et soutenir l’économie.
Respecter nos spécificités : c’est un impératif pour répondre aux enjeux spécifiques auxquels sont confrontés nos RUP : l’éloignement, le coût de la vie, le défi de l’autonomie alimentaire, la problématique des transports…
Ouvrir de nos nouveaux horizons : c’est une urgence pour que les RUP soient considérées comme des territoires de solutions pour l’Europe, et pas seulement comme des territoires de subventions.
La nouvelle stratégie que je propose invite ainsi à changer le regard sur les Outre-mer. Nous devons être vus comme des territoires moteurs de la transition écologique, de l’économie bleue, comme des pôles d’innovation et de recherche… Mon rapport propose ainsi de créer des campus d’excellence pour la jeunesse ultramarine, de s’appuyer sur les RUP pour déployer les énergies renouvelables et faire émerger les métiers de demain, ou encore de construire des centres de recherche sur la santé et la biodiversité.
L’ambition de mon rapport, c’est de faire de l’Europe une chance pour nos Outre-mer, de nos Outre-mer des atouts pour l’Europe.
MH : Dans le volet « politique agricole« , le rapport demande que soit renforcé plusieurs dispositifs spécifiques. Pourquoi ? Sont-ils à ce jour insuffisants selon vous ?
S. B. : Notre monde agricole a bien conscience qu’il faut engager et réussir les transitions agro-écologiques et la diversification. Notre responsabilité, c’est d’accompagner nos planteurs, nos éleveurs et aussi nos pêcheurs. Le cap avait été fixé par le président de la République lui-même quand, en 2019, il avait annoncé un objectif clair : travailler ensemble pour atteindre l’autonomie alimentaire dans les DROM en 2030.
Mais, la même année, notre ambition a été percutée par une tentative paradoxale et unilatérale de la Commission européenne qui a voulu baisser le mondant du POSEI, le programme européen d’aides à notre agriculture. En tant de député européen, et avec mes collègues parlementaires, nous avons immédiatement combattu cette manœuvre agressive et contre-productive qui constituait de fait, une entorse inadmissible à l’obligation européenne de respecter nos spécificités. Je défendrai toujours le POSEI. C’est un levier essentiel pour aider nos planteurs et nos éleveurs. Protéger et développer notre production locale est à la fois une nécessité et un impératif.
Le POSEI, c’est surtout un outil indispensable pour aider les RUP à relever le défi de l’autonomie alimentaire : pour structurer l’agriculture et l’élevage ultramarins, pour diversifier les filières agricoles et garantir l’attractivité des métiers agricoles notamment pour les jeunes. Au Parlement européen, nous nous sommes beaucoup mobilisés et avec un soutien actif du gouvernement français, nous avons obtenu le maintien du budget du POSEI. Dans les RUP françaises, ce sont donc 278 millions d’euros qui continueront à soutenir chaque année notre modèle familial pour une agriculture de qualité.
Nous avons un objectif : l’autonomie alimentaire. Nous avons une urgence : la diversification et la transition agro-écologique. Les hommes et les femmes qui travaillent dur dans le monde agricole pourront toujours compter sur mon engagement. Le chemin du succès doit impérativement conjuguer développement et protection et d’ailleurs, dans mon rapport, je propose également de renforcer la protection de nos productions locales dans le cadre des accords commerciaux conclus par l’UE.
MH : Il y est aussi question de renforcer l’attractivité des métiers agricoles notamment. Comment ? Cela signifie-t-il que le secteur ne compte pas suffisamment de professionnels au sein des RUP ?
S. B. : Nos agriculteurs et nos éleveurs sont de vrais professionnels et ils ont un solide savoir-faire. Nos jeunes ont besoin de perspectives, alors nous devons renforcer l’attractivité des métiers agricoles à la fois pour assurer la relève et pour innover. Dans le cadre de la réforme de la PAC, nous nous sommes d’ailleurs battus au Parlement européen pour mieux accompagner l’installation des jeunes agriculteurs.
Face aux défis d’aujourd’hui et de demain : l’Europe doit financer des infrastructures modernes, accompagner les territoires ruraux, développer des formations en lien avec nos nouveaux besoins mais nous devons aussi trouver des solutions pour sécuriser la qualité des sols.
Pour réussir, il faut des moyens financiers bien évidemment. Des outils efficaces comme le POSEI ou le FEADER doivent être consolidés mais nous devons aussi mieux coordonner les actions de tous les acteurs du secteur, l’Europe, l’État, les collectivités locales et les professionnels doivent travailler ensemble et avancer dans le même sens.
MH : Comment concilier politique agricole et développement durable, alors que les territoires d’Outre-mer sont plus touchés que l’Hexagone par le réchauffement climatique ?
S. B. : Concilier l’agriculture et le développement durable revient à concilier économie et écologie, à garantir à la fois la prospérité de nos filières et la protection de nos ressources mais aussi de la biodiversité.
Les RUP sont des territoires particulièrement confrontés à ces défis, et probablement plus que les autres. Les Outre-mer abritent 80% de la biodiversité et nous sommes en première ligne des risques climatiques. Mais compte tenu de leurs spécificités géographiques, nos régions peuvent être aussi des territoires moteurs pour déployer des solutions en matière d’agriculture durable.
Dans mon rapport, je propose de fixer des objectifs pragmatiques et innovants et de sécuriser des moyens pour la transition agro-écologique.
Nous avons lancé une dynamique du changement avec un culture du résultat : la nouvelle PAC que nous avons adoptée n’a jamais été aussi verte. Plus nos agriculteurs et éleveurs agiront en faveur de l’environnement et du climat et plus ils seront financièrement soutenus.
L’UE a aussi proposé une stratégie « De la ferme à la table », qui a pour ambition de garantir un système agricole et alimentaire européen sain et durable. Nous ferons en sorte que les agriculteurs et éleveurs ultramarins soient des partenaires incontournables de cette stratégie.
Lorsqu’on parle de lien entre environnement et agriculture, il faut aussi répondre à l’enjeu de l’impact des risques climatiques sur l’agriculture et les récoltes. Ces risques sont particulièrement importants pour les RUP, qui sont régulièrement confrontées à des ouragans ou des cyclones.
La semaine dernière, le président de la République a annoncé un plan national de 600 millions d’euros par an pour aider nos agriculteurs en finançant un système de gestion des risques climatiques. Ce système mobilisera des fonds nationaux et européens.
Je réaffirme que nous devons jouer la carte de l’intelligence collective, de la mutualisation de nos expertises, de la confiance et du partage des solutions. Plus que jamais, l’Europe est un partenaire indispensable de notre avenir. Être à la fois, Mahorais, Français et Européen est un atout considérable pour relever les défis que nous devons affronter pour nous et pour nos enfants.
Découvrez en plus sur le nouveau numéro de Mayotte Hebdo
Les chiffres clés de l’agriculture dans les Outre-mer
Alors que les surfaces agricoles représentent 56% du territoire hexagonal, soit 29 millions d’hectares, le ministère de l’Agriculture estiment comme suit les surfaces agricoles utilisées pour chaque département d’Outre-mer :
• 30% pour la Guadeloupe (52.000 ha) sur 7.000 exploitations agricoles ;
• 20% pour La Réunion (47.000 ha) sur 7.700 exploitations ;
• 0,4% en Guyane (31.000 ha) sur 6.000 exploitations ;
• 30% en Martinique (30.000 ha) sur 3.000 exploitations ;
• 20% à Mayotte (8.700 ha) sur 15.700 exploitations.
Pour atteindre l’objectif d’autonomie alimentaire dans les DROM à l’horizon 2030 annoncé en 2019 par Emmanuel Macron, les départements ultramarins doivent étendre comme suit leur production locale de produits tropicaux et légumes afin de remplacer les importations :
• 95 ha pour Mayotte ;
• 178 ha pour la Guyane ;
• 500 ha pour La Réunion ;
• 511 ha pour la Martinique ;
• 764 ha pour la Guadeloupe.
Des projets dans les cartons
En mai 2021, 67 projets agricoles agroalimentaires et de la filière forêt-bois, contribuant à l’objectif d’autonomie alimentaire, ont été nommés lauréats pour le plan France Relance dans les départements d’Outre-mer, avec un soutien de l’État de près de 15 millions d’euros. À Mayotte, dans le cadre de ces projets, l’entreprise Mayotte Pépinières va moderniser son outil de production, augmenter ses rendements et diminuer la pénibilité du travail de ses collaborateurs en acquérant des tables de culture, du matériel de terrassement et une réserve d’eau. Aussi, la société Les moustaches de l’hippocampe à Pamandzi portent un projet de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de vie.