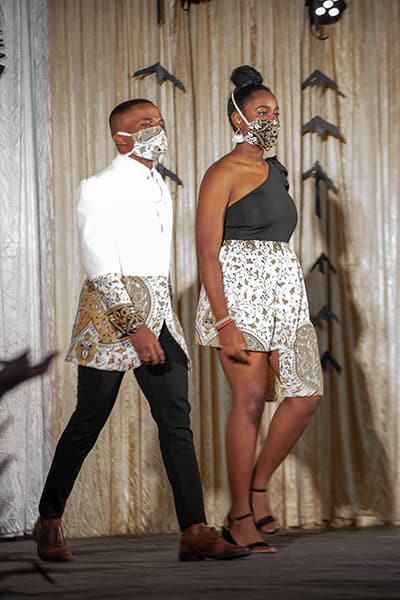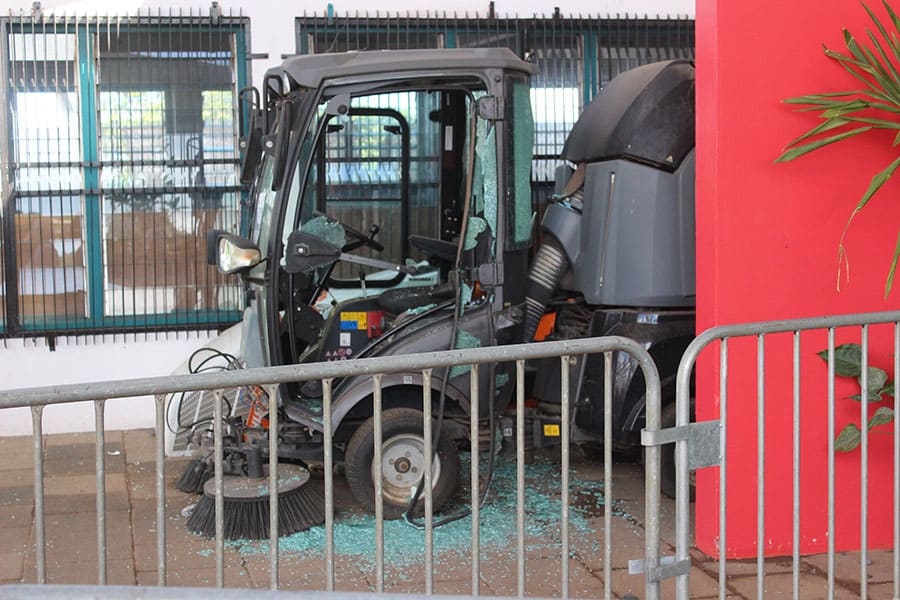Depuis six mois, Mako a transformé sa terrasse en potager. Aidée par l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte et le centre communal d’action sociale de Sada, l’assistante maternelle de profession est devenue jardinière amateure. Une opportunité de consommer des produits locaux et de saison, sans pesticides.
Tous les jours, de bonne heure et de bonne humeur, Mako se rend sur sa terrasse. “Je prends plaisir à monter de bon matin à 5h. Je reste sur mon toit quarante-cinq minutes à une heure pour m’occuper de mes plantations”, confie la jardinière en herbe. Dans les bacs en bois, tomates et salades poussent sous le soleil de Sada. “J’avais déjà cette idée d’utiliser ma terrasse comme potager”, confie Mako. Avant d’ajouter : « j’avais parlé de cela à mes amis et mes voisins et par le bouche à oreille, les salariés de l’Epfam sont venus à ma rencontre pour me proposer de participer au projet d’expérimentation des toitures végétalisées.”
Une véritable opportunité pour l’assistante maternelle qui se dit ravie des conseils et du suivi que la structure lui a apporté. “J’ai été très bien accompagnée par Claire Colliaux qui est chargée de mission agriculture urbaine. Nos échanges étaient aisés et les choses se sont mises en place facilement”, confie la jardinière. En rejoignant ce programme, Mako a pu bénéficier d’une aide à l’installation de son jardin potager grâce à des aménagements financés par l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte, la préfecture, le conseil départemental, l’Union européenne, Leader France et le groupe d’actions locales Ouest Grand Sud de Mayotte. Bacs de jardinage, filets de protection, étanchéité du toit terrasse, accès et sécurisation de celui-ci, mais aussi installation d’une citerne de récupération des eaux de pluies ou encore financement d’un appareil de mesure de l’hygrométrie, autant d’outils que Mako et deux autres familles sadoises participantes au projet ont pu recevoir.
Un espace d’expérimentation
C’est une arlésienne : le foncier est rare à Mayotte. En utilisant les toits terrasses comme lieu de production d’une agriculture vivrière, l’Epfam fait le pari d’apporter plus de “vert” en ville. En se lançant dans ce projet, les jardiniers amateurs ont accepté de réaliser un suivi précis pendant trois ans de leurs récoltes, de noter leurs quantités ou encore de faire état des maladies que les plantes peuvent attraper. Sur leurs terrasses, des bacs de différentes formes et contenances accueillent les légumes. Certains sont au soleil, d’autres à l’ombre et jour après jour, leurs propriétaires analysent la productivité de ceux-ci. De quoi réaliser un véritable guide sur l’agriculture urbaine qui pourra par la suite servir aux Mahorais souhaitant tenter l’expérience.
Un travail d’équipe
Au départ, tout est parti d’une mésaventure qui est arrivée à Mako ou plus précisément à ses lapins. “Ma fille s’est rendue au marché pour acheter de la salade pour ses lapins. Lorsqu’elle a donné cette salade soit disant bio à ses animaux, ils sont morts et l’eau dans laquelle nous avons rincé la salade ensuite afin de vérifier ce qui avait pu les tuer était orange !”, s’exclame la mère de famille. Un épisode qu’elle n’est pas prête d’oublier et qui lui a donné l’envie de cultiver ses propres légumes. Aujourd’hui, les tomates qu’elle consomme au quotidien et dont les enfants qu’elle garde raffolent, poussent sans aucun intrant. De l’eau, de la terre, du soleil et c’est tout !
Plantés dans des bacs confectionnés par des jeunes en insertion du centre communal d’action sociale de Sada, les cultures fleurissent sous le regard attentif de la maîtresse de maison. “Je n’avais jamais fait d’agriculture avant. J’ai d’abord commencé par planter des fleurs pour égailler ma cour et aujourd’hui, je plante toujours plus d’essences différentes. J’ai également suivi avec le programme de l’Epfam trois demi-journées de formation avec un intervenant du CFPPA (centre de formation professionnelle et de promotion agricole) de Coconi”, confie l’assistante maternelle. À l’heure actuelle, Mako récolte trois kilos de tomates cerises par jour ! De quoi rassasier toute la famille mais aussi les voisins et les curieux qu’elle invite avec grand plaisir à faire visiter son potager.