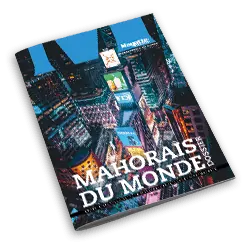{xtypo_dropcap}M{/xtypo_dropcap}ayotte Hebdo : Dans votre livre, vous décrivez des rapports parfois très tendus avec vos collègues… Vous évoquez les problèmes de recrutements affinitaires du "circali titi" (conseil général) et la "politique du ventre"… Vous parlez de dette morale envers les élus et leur famille.
Allaoui Askandari : Les élus vivent cette "politique du ventre", mais ils ne conçoivent pas le conseil général comme un moyen pour y arriver. Je pense qu'ils sont pris dans un engrenage, ils ne sont pas les maîtres du jeu. Par contre, un certain nombre d'agents conçoivent leur mission comme un "marzik", c'est-à-dire une prescription de Dieu faite à Sa créature. Comme les règles du jeu ont été biaisées dès le départ, c'est-à-dire dès la phase du recrutement, la suite se retrouve également biaisée, soit parce qu'on n'a pas été retenu pour son mérite, soit parce qu'il n'y a pas eu de concurrence préalable. Quand le supérieur hiérarchique qui a recruté cette personne n'est plus en place, ce n'est pas forcément évident pour son remplaçant de remettre la personne sur les rails ensuite.
Il y a aussi la question des compétences : généralement, quand on amène une personne et qu'on va la placer quelque part, on ne cherche plus à savoir si les missions qui vont lui être assignées correspondent à son profil. Au final, le supérieur hiérarchique ne sait pas comment s'en débarrasser. Il ne peut plus demander d'autres recrutements car il a un effectif suffisamment étoffé. Il finit donc par se résoudre à la situation de fait. Il se dit : "On va faire avec…". Mais pour faire avec, il y a des limites par rapport à ce qu'il convient de demander à cette personne.
MH : Vous estimez que le favoritisme dans le recrutement constitue une part importante des effectifs du conseil général ?
AA : Ce n'est même plus du favoritisme, parce qu'à la limite, si vous vous recrutez et que je vous présente une liste de candidats, et que vous choisissez sur la liste en favorisant, là on parlera de favoritisme. Mais si vous, en tant que directeur, on vous amène une personne, vous vous retrouvez devant un fait accompli. C'est autre chose que du favoritisme parce que ce ne sont pas les directeurs qui choisissent. Il y a déjà eu un choix qu'on leur impose.
{xtypo_quote}On a été longtemps habitué à avoir un supérieur hiérarchique Blanc, donc ce n'est pas naturel de se retrouver un jour sous les ordres d'un Noir. Et puis, culturellement, il n'est pas bien vu de se démarquer{/xtypo_quote}
MH : Et c'est trop dangereux pour eux de licencier ensuite le personnel incompétent ?
AA : Licencier alors que ce n'est pas vous qui avez recruté, c'est déjà problématique. L'agent peut dire à son supérieur : "De toute façon, ce n'est même pas vous qui m'avez installé là". Ensuite, nous, Mahorais, partageons un certain nombre de choses en commun, notamment des recours à la sorcellerie, à des prières… Et comme nous partageons tous ces choses-là, on n'y est pas indifférent. Donc, vous, directeur, si vous envisagez de me licencier, il y a toute cette représentation-là qui vous hante, qui vous habite et donc ce n'est pas simple de s'en débarrasser. Le directeur peut avoir peur qu'on lui jette un sort, sans parler des pressions familiales qui peuvent intervenir auprès des élus.
MH : Selon vous, la politique de domination du Blanc qui avait lieu pendant la période coloniale est toujours intériorisée par les agents de l'administration "noire" du conseil général. Sur quoi vous basez-vous pour l'affirmer ?
AA : Je me base sur des propos. Nous avons coutume de dire : "tsi lo fania hazi ya mzungu" ("je viens d'effectuer le travail du Blanc"). Je me base aussi sur l'observation de la nature des rapports hiérarchiques. Quand vous êtes directeur et que vous êtes Noir, vous devez faire beaucoup plus pour qu'on vous reconnaisse comme étant un directeur "normal". On vous juge davantage, on cherche souvent à voir si vous êtes ou non à la hauteur. C'est comme si cette personne-là n'était pas à sa place. On a été longtemps habitué à avoir un supérieur hiérarchique Blanc, donc ce n'est pas naturel de se retrouver un jour sous les ordres d'un Noir.
Et puis, culturellement, il n'est pas bien vu de se démarquer. Je fais beaucoup référence dans mon ouvrage à René Bureau qui explique assez bien que le démarquage, la distinction sont conçus comme mauvais pour l'équilibre matriciel du groupe. Quand il y en a un qui se démarque, qui s'échappe, cette désolidarisation fait peur, intrigue le groupe. Il y a des mécanismes, souvent inconscients, qui cherchent à ramener l'individu qui s'est distingué, pour ressouder le groupe.
Aujourd'hui, on peut se démarquer parce qu'on a fait des études. Ce qu'on ramène de l'Occident, les autres ne l'ont pas et ne le comprendront pas. C'est un double démarquage en quelque sorte. Les personnes qui se retrouvent dans cette situation le vivent très difficilement.
{xtypo_quote}Si on s'échange des écrits et que ces productions ne sont pas lues, ça handicape naturellement le bon déroulement des choses. On attend que le contenu d'un papier soit lu pour qu'on puisse avancer, mais c'est très rarement le cas{/xtypo_quote}
MH : Vous dites dans votre conclusion que "les prévarications se multiplient, se cautionnent et s'érigent en normes". Est-il réellement impossible d'établir à Mayotte les bases politiques occidentales importées ?
AA : Il faudrait mettre en valeur les éléments que nous sommes allés chercher dans les écoles occidentales. Les vertus du dialogue par exemple. Les gens reviennent mais sont obligés de mettre de côté toute cette richesse intellectuelle et culturelle qu'ils ont héritée de ces écoles républicaines. Il faudrait développer des structures de type "cafés philosophiques" pour qu'on donne de la place à cette mouvance.
Les initiatives personnelles devraient être soutenues par les hommes politiques pour qu'elles ne s'épuisent pas. Ces "je viens de…", ces acculturés sont vulnérables dans le territoire parce que lorsqu'ils cherchent à se démarquer, ils se construisent des ennemis. Il faut essayer de les soutenir parce que ce sont des "pangolins", l’incarnation de la "contre-nature", comme je dis dans mon ouvrage. Les hommes politiques doivent mettre en place des dispositifs pour exploiter toute cette richesse, car toute faculté non utilisée régresse. En fin de semaine, il y a des soirées partout. En revanche, des cercles intellectuels par exemple, ça manque.
MH : Vous dites que les exigences bureaucratiques se heurtent aux traditions mahoraises que sont par exemple le droit d'ainesse, le rapport à la chose écrite ou la notion d'intérêt général. Toute évolution vers une culture occidentale de l'administration est-elle impossible ?
AA : Dans l'administration, il y a beaucoup d'écrits qui circulent. Si on s'échange des écrits et que ces productions ne sont pas lues, ça handicape naturellement le bon déroulement des choses. On attend que le contenu d'un papier soit lu pour qu'on puisse avancer, mais c'est très rarement le cas.
Pour comprendre le droit d'ainesse, il y a l'âge mais aussi l'ancienneté dans un service. Traditionnellement, c'étaient les aînés qui donnaient les instructions. Quelque part, on transpose ce modèle-là dans l'administration et ce n'est pas évident pour de nouvelles recrues, même quand ils ont des idées géniales, de s'imposer, de proposer. Il y a une forte résistance au changement et on finit par se taire, se fondre aux habitudes du lieu et du moment. On finit aussi par cautionner ce qui se vit, c'est là que je parle de "prévarications qui s'érigent en normes".
{xtypo_quote}Traditionnellement, c'étaient les aînés qui donnaient les instructions. Quelque part, on transpose ce modèle-là dans l'administration et ce n'est pas évident pour de nouvelles recrues, même quand ils ont des idées géniales, de s'imposer, de proposer{/xtypo_quote}
MH : On fait également semblant de ne pas voir, c'est ce que vous appelez le "conformisme de façade"…
AA : Au niveau du discours, on peut produire le même type qu'en Occident, mais ca va s'arrêter là. On passera rarement à l'action pragmatique. Il y a un adage mahorais qui dit "kwéli ya maoré kouiji" ("la vérité du Mahorais, tu ne la sauras jamais"). On dit aussi "inhin tsi mdzo wawtrika" ("acquiescer ou dire oui n'est pas un fardeau") et dire "non", c'est impoli. On s'arrange, quand on est en face-à-face, pour être poli, ne pas se contrarier. Mais après, quand il s'agit de s'investir par rapport aux engagements qui ont été pris, les choses ne vont pas jusqu'au bout. On se décourage à un moment donné et puis on se dit : "si c'est untel, il est comme ça". On naturalise cette attitude. On privilégie la courtoisie et les bonnes relations plutôt que l'efficacité. On finit tous par s'y résoudre car on se fait plus d'ennemis que d'amis si on persiste dans cette lancée "suicidaire".
MH : Sur quoi vous basez-vous pour affirmer que les services déconcentrés de l'Etat "saidcoucouillent" (entravent) les évolutions que peuvent apporter les services du conseil général ?
AA : Par saidcoucouiller, j'entends par là mettre la bride sur les choses pour les empêcher de se mouvoir. Je me base sur des éléments très concrets. A sein du Crij (Centre régional d'information jeunesse), il y a eu des pratiques que nous condamnions, nous, le service du conseil général. Bien que nous soyons le principal financeur, le Crij est allé se faire "couver" par la direction de la jeunesse et des sports (DJS), le service de l'Etat, qui cautionne en quelque sorte ces pratiques malveillantes.
Il y a eu aussi un OMJS (Office municipal de la jeunesse et des sports) où le président faisait n'importe quoi. La coordinatrice Fonjep (Fonds de coopération de la jeunesse et l'éducation populaire) avait le droit de tout voir, sauf les factures et le bilan financier. Je lui avais personnellement recommandé d'essayer de convoquer le CA "fantôme" pour qu'il redéfinisse ses missions. Ce poste est financé à moitié par l'Etat et à moitié par le conseil général. Le service de l'Etat a écrit un courrier au président pour lui dire que la DSAJ n'a aucune prérogative sur ces postes Fonjep et n'a pas le droit d'intervenir, alors que c'est faux ! Ce sont des pratiques qui court-circuitent des initiatives locales qui viennent du côté de la DSAJ.
{xtypo_quote}Dire "non", c'est impoli. On s'arrange, quand on est en face-à-face, pour être poli, ne pas se contrarier. Mais après, quand il s'agit de s'investir par rapport aux engagements qui ont été pris, les choses ne vont pas jusqu'au bout{/xtypo_quote}
MH : Mais d'après vous, pourquoi les agents de l'Etat réagiraient ainsi ?
AA : Il me semble qu'ils sont restés dans un mode de gouvernance archaïque. Ils ont du mal à suivre cette évolution vers la décentralisation. Ils ont toujours été chefs de tout le monde jusqu'en 2004 et ont du mal à faire ce deuil, ce qui explique leur comportement.
MH : En quoi consiste le dispositif PEL (Politique éducative locale), que vous développez longuement dans votre ouvrage ?
AA : C'est une politique de jeunesse qui fait tant défaut à Mayotte. On voudrait amener les communes à avoir leur service municipal de la jeunesse et des sports. Il y en a un qu'à Mamoudzou, mais il n'est pas encore suffisamment structuré. La PEL, c'est faire en sorte que la multitude d'actions qui sont menées dans le territoire puissent connaître une certaine articulation entre elles et qu'elles puissent être au service de l'intérêt général. Car ce qu'on observe actuellement, c'est plutôt des "tournois" d'actions : chaque association, chaque structure fait ses projets dans son coin sans forcement qu'il y ait un œil attentif des services publics sur l'action menée et sur comment l'argent public est utilisé.
Il faut faire en sorte qu'il y ait une politique cohérente dans les localités diverses, mais aussi qu'il y ait un tissu associatif structuré. La PEL existe en Métropole depuis 1998 et a atterri ici en 2001, mais à ce jour, malgré les tentatives multiples qui ont été entreprises, les choses ont toujours du mal à prendre forme. Les difficultés qui se dressent sont celles que je viens de mentionner, c'est-à-dire les différentes formes de conformisme au niveau institutionnel, mais aussi au niveau local, nous avons du mal à avoir des interlocuteurs porteurs de projets. On est aussi dans un domaine émergent : l'animation jeunesse ou l'éducation de rue, ce ne sont pas encore des choses reconnues comme vraiment utiles. Nous avons 60% de jeunes de moins de 25 ans. Avec la montée de la délinquance, c'est un domaine qui va s'imposer de fait, même si on n'en voit pas encore l'importance. Cette réalité va à un moment donné interpeler les élus, ce sera peut-être un petit peu tard, mais mieux vaut tard que jamais…
Propos recueillis par Julien Perrot
Mayotte Hebdo vise à contribuer au développement harmonieux de Mayotte en informant la population et en créant du lien social. Mayotte Hebdo valorise les acteurs locaux et les initiatives positives dans les domaines culturel, sportif, social et économique et donne la parole à toutes les sensibilités, permettant à chacun de s'exprimer et d'enrichir la compréhension collective. Cette philosophie constitue la raison d'être de Mayotte Hebdo.