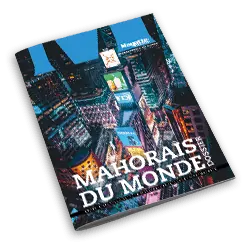Le Parlement de la rivière Ourovéni s’est réuni pour la deuxième fois ce mercredi, sur la parcelle agricole de Mouhamadi « Foundi Madi » Ahamada, à Tsingoni. Un lieu choisi pour aborder la thématique du jour : l’agriculture. Les chercheurs du projet PLASMA (Pollution aux microplastiques du lagon de Mayotte), à l’initiative de ce parlement citoyen lancé en novembre 2024 et accompagné par la Régie de territoire de Tsingoni (RTT) et le Parc naturel marin de Mayotte, a animé la matinée d’une quarantaine de participants.
Pour endiguer la pollution du lagon, avoir une rivière saine est nécessaire : c’est tout le but du Parlement. C’est pour cela que les différents membres de l’assemblée citoyenne ont échangé sur l’agriculture, dont les pratiques peuvent avoir une incidence directe sur les cours d’eau. Le jardin mahorais, proche de l’agro-foresterie, revient dans toutes les bouches comme pratique vertueuse pour les rivières. “Moi je ne mets pas de pesticide, tout pousse naturellement”, indique « Foundi Madi », dont le jardin mahorais bio d’un hectare lui a permis de remporter la médaille d’argent pour sa vanille au Salon de l’agriculture. « Il faut arriver à rendre attractif le jardin mahorais. La superficie recule en jardin mahorais au profit du maraîchage, plus rentable rapidement, avec l’utilisation d’engrais interdits », analyse Calvin Picker, conseiller pour le développement de l’agriculture biologique de l’Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (Epfam). Sauf que le maraîchage et la monoculture favorisent l’érosion et l’envasement du lagon, la terre n’étant pas retenue par des racines.
Cinquante agriculteurs bio à Mayotte
Mathieu Leborgne, sociologue et co-animateur du projet Plasma, note que convaincre après Chido d’adopter un modèle agricole plus lent va s’avérer compliqué. « En effet, cela fait cinquante ans qu’on pousse les gens à sortir du traditionnel pour le moderne. Il faut entrer dans une dynamique de déconstruction aujourd’hui. C’est encore plus dur avec le cyclone, mais il faut le faire », répond Calvin Picker, qui estime que pour qu’une parcelle de jardin mahorais soit rentable, il faut au moins deux hectares et produire un produit spécifique comme la vanille ou le café. Mais la marge de progression pour limiter les intrants qui polluent ensuite les rivières reste vaste : sur les 1.500 agriculteurs enregistrés sur l’archipel, cinquante seulement ont leur exploitation certifiée biologique.
Une problématique qui met en avant la précarité des agriculteurs mahorais. « Pour moi, c’est un revenu complémentaire », indique « Foundi Madi », qui comme beaucoup d’autres, ne peut pas vivre de ses cultures. « Mais s’il y avait moins de vols, je pourrais avoir un Smic », ajoute-t-il. Le vol des récoltes se pose comme un gros problème pour la rentabilité des parcelles. L’agro-tourisme est alors évoqué par Émilien Dautrey, directeur du groupement d’étude et de protection des oiseaux de Mayotte (Gepomay), comme une solution pour compléter les revenus. Des acteurs du syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (Sidevam), du Parc marin, de Mayotte Nature Environnement (MNE), de la RTT, du monde agricole ou encore de la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte (Dealm) ont ainsi échangé toute la matinée autour de ces problématiques.
« Le but n’est pas de trouver des solutions en quelques heures, mais de réfléchir ensemble à des pistes d’amélioration », commente Mathieu Leborgne.
Journaliste à Mayotte depuis septembre 2023. Passionnée par les sujets environnementaux et sociétaux. Aime autant raconter Mayotte par écrit et que par vidéo. Quand je ne suis pas en train d’écrire ou de filmer la nature, vous me trouverez dedans.