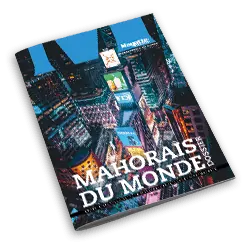L’esclavage à Mayotte est une période sombre qui a longtemps été niée, mais qui a bel et bien existé. L’historien Inssa de Nguizijou a contribué à faire connaître ce pan de l’histoire. Il a notamment écrit le livre « L’esclavage à Mayotte et dans sa région : du déni mémoriel à la réalité historique ». Dans le Mayotte Hebdo numéro 1086 et avant la journée de commémoration du 27 avril, il revient sur les faits et les détails de l’esclavage sur l’île.
Mayotte Hebdo : Comment l’esclavage est arrivé à Mayotte ?
Inssa de Nguizijou : On entend souvent dire qu’on peut dater l’esclavage du IX au Xème siècle à Mayotte, mais ce n’est pas vrai parce que la société qui s’est installée à Mayotte tout au long du Moyen-âge, n’a pas laissé de trace d’une quelconque organisation basée sur l’esclavage. En revanche, on retrouve des traces d’esclavagisme, d’inspiration orientale, lié à la mise en place des sociétés arabo-shiraziens en provenance du Moyen-Orient. Cela commence vers le début du XVIème siècle. On n’a pas de dates précises.
Tout au long de la côte Est africaine, les vagues de migrations venant de la Perse et du golfe arabo-persique vont s’installer avec leur système de valeur. Et parmi les valeurs il y a le travail. Une certaine caste considère que travailler la terre, travailler avec ses mains est un déshonneur. Ils vont donc importer des noirs du continent pour prendre en charge tout le travail manuel.
M.H. : Qui étaient les maîtres ?
I.de N. : Les maîtres étaient des Arabo-perses, ainsi que l’élite locale puisque lorsque les Arabo-perses arrivent à Mayotte, il y a déjà des sociétés installées. Le mode opératoire pour les intégrer est de se marier avec les classes dirigeantes de ces sociétés et de fonder une dynastie métisse. Il y a donc les arabes purs, leurs descendants et la caste des dirigeants qui étaient déjà sur place. Ils vont tous former la caste des « kabayla ».
M.H. : Comment était organisée la société ?
I.de N. : C’est une organisation pyramidale et féodale. Il y avait trois castes. En haut de la pyramide on avait les « kabayla », au milieu les « wa gwana », ce sont des personnes totalement libres qui représentent l’ancienne population trouvée sur place. Ils n’ont pas forcément intégré la caste supérieure mais ils sont restés libres dans leur manière de travailler et mener leur vie. Et à la base de cette pyramide il y a les esclaves qui sont majoritaires au sein du corps social. Ils travaillent pour les castes supérieures. On les appelle les « wa rumoi ».
M.H. : Aujourd’hui, la question de la caste est moins présente, mais on note tout de même une différence entre les personnes foncées et ceux qui sont clairs de peau. Comment expliquer cela ?
I.de N. : Oui, c’est une réalité. Les bourreaux ont inculqué aux victimes une manière de percevoir le monde et les couleurs de peau. L’épiderme a toujours un sens social. Plus on est foncé, plus on va nous renvoyer vers des origines serviles. Plus le teint est clair et plus on va nous renvoyer à des origines nobles, à un héritage de sang arabe. C’est un raccourci qui a été créé dans la tête. C’est le drame de la dépigmentation de la peau. Se débarrasser de la peau noire, c’est aller vers ces castes dites supérieures. L’esclavage n’existe plus, mais il y a encore des stigmates, des traumatismes que l’on traine aujourd’hui.
M.H. : On a tendance à dire que l’esclavage à Mayotte était « doux ». Est-ce vrai ?
I.de N. : Qu’est-ce qu’on considère comme douceur dans la servilité ? Il faut balayer cette affirmation et revenir aux faits. Pendant la période arabo-shirazienne et durant la période française de l’engagisme, il n’y a rien de doux dans la manière de conduire la vie des assujettis. On tend à dire que l’esclavage était « doux » car des personnes ont bénéficié de largesse dans l’affranchissement parce qu’elles étaient proches du maître. Et c’était plutôt les esclaves qui évoluaient dans le milieu urbain. Ceux qui vivaient à proximité du maître pouvaient bénéficier d’une certaine clémence relative. Mais dès qu’on s’éloigne du milieu urbain, on se rend compte que la dureté du travail n’est en rien douce. Les esclaves agricoles et marins avaient une vie très dure. Les esclaves femmes étaient assujetties sexuellement. Cette réalité n’a rien de doux. J’ai étudié la folie et le système esclavagiste était tellement oppresseur que certains sont devenus fous et folles. Ils le sont devenus à la suite du traitement qu’ils ont subi, parce qu’ils n’auraient pas été emmenés pour travailler s’ils étaient fous depuis chez eux.
M.H. : Quelle est la différence avec la période de l’engagisme et du colonialisme ?
I.de N. : Lorsque l’on s’intéresse à la période de la colonisation française, on s’aperçoit que durant l’engagisme c’est juridiquement une forme différente du travail, mais dans la réalité les personnes engagées deviennent des esclaves puisque dans leurs contrats il était précisé qu’on leur devait une rémunération en contrepartie de leur travail, mais dans la réalité elles n’étaient pas payées ou étaient payées très tardivement, c’est à dire dix à douze mois de retard de salaire. Dans ces cas-là, il y a une rupture du contrat de travail.
Il y a un autre aspect à prendre en compte, ce sont les humiliations et les mauvais traitements dans les plantations. On n’est pas loin de la réalité réunionnaise, guadeloupéenne de la condition des engagés. La question qui se pose est de savoir si on est dans l’engagisme ou toujours dans une forme d’esclavagisme qui ne dit pas son nom.
M.H. : Comment étaient organisés les quartiers dans les villes ?
I.de N. : Les villes murets, c’est-à-dire les médinas, représentent la ségrégation spatiale. Une médina appelle forcément à une interprétation sociale qui exclut un certain nombre de personnes. Les nobles, les commerçants, ceux qui possèdent le pouvoir politique, habitent dans la médina. La population servile vit en dehors. Ce schéma n’a pas changé aux Comores. L’exemple d’Anjouan est le plus parlant car les médinas existent encore ainsi que le système de caste. D’ailleurs, parmi les explications du problème d’immigration actuelle c’est qu’il y a des personnes qui n’arrivent pas à trouver leur place dans la société anjouanaise. Au-delà des aspects qu’on a l’habitude d’entendre, ils fuient leur île pour trouver une dignité d’être-humain. C’est une bouffée d’oxygène moral pour eux car ici ils sont considérés comme des humains avec des droits.
M.H. : Comment en est-on sorti ?
I.de N. : Lorsque le colonisateur est arrivé sur place, il s’est aperçu que pour mettre en place son système colonial il lui fallait de la main d’œuvre. Et ceux qui en avaient, étaient les Kabayla. Donc, le seul moyen de s’en accaparer pour construire les routes, les usines, mettre en place les ateliers coloniaux, c’est de libérer cette main d’oeuvre en abolissant l’esclavage. Les colonisateurs n’ont pas aboli l’esclavage pour les beaux yeux des Mahorais, mais plutôt pour utiliser ces personnes dans leurs intérêts.
Le pouvoir décide d’abolir l’esclavage le 9 décembre 1846, par ordonnance royale, mais cette abolition s’accompagne d’une obligation des affranchis de s’engager auprès de l’administration, des concessions ou encore de tout autre entité qui peut les engager pour éviter qu’ils soient dans l’oisiveté. On va racheter leur liberté en indemnisant leurs propriétaires, en tout cas ceux qui avaient émis le souhait d’affranchir leurs esclaves. Mais à partir de ce moment, ceux qui ont été affranchis se rendent comptent que leurs conditions de travail ne diffèrent pas trop de l’esclavagisme auquel ils étaient habitués quelque temps avant. Donc ils se révoltent en 1847 pour dénoncer cela.
De plus, même si on était affranchi, on avait toujours des stigmates de cette servilité parce qu’au moment de l’affranchissement il y avait un rituel où on faisait des scarifications sur le front. À l’époque c’était un code pour notifier à la société que cette personne a été esclave mais ne l’est plus. Socialement ça restait un poids.
M.H : Pourquoi a-t-on du mal à reconnaître ce passé ?
I.de N. : Il y a un déni certain, une mémoire qui se veut oublieuse. Pour autant les preuves de l’existence de l’esclavage existent. On a une société qui a une approche de la mémoire assez volatile. On se concentre sur le présent car c’est le plus important. On a d’autres problèmes plus urgents qui nous font oublier ceux du passé. C’est ce qui explique en partie le déni, volontaire ou pas volontaire. Il y a aussi un autre aspect, c’est la méconnaissance. Il y a des personnes qui ne savent pas que l’esclavage a existé à Mayotte. Le fait qu’on ne sache pas cela ne participe pas non plus à la libération de la parole. Ils nous demandent des preuves. Même des élus tiennent ce discours et ça complique notre travail.
Il y a un déni de la réalité mais le travail d’histoire permettra d’effacer le négationnisme de l’esclavage à Mayotte.
M.H. : Quel travail faites-vous pour cela ?
I.de N. : Aux archives départementales de Mayotte nous intervenons dans les établissements scolaires. On a trois, quatre expositions qui circulent dans les écoles. Les enseignants doivent aussi faire le travail, mais on ne peut pas dire qu’on n’a pas de support. Ce discours était compréhensible il y a quelques temps, mais aujourd’hui, on a des éléments qui permettent d’apporter de la connaissance avec beaucoup de pédagogie aux élèves.
Un événement organisé au marché d’Hajangoua
Au marché couvert d’Hajangoua, à partir de 9 heures, dimanche 27 avril, une commémoration de l’abolition de l’esclavage est organisée par la communauté d’agglomération de Dembéni et Mamoudzou (Cadema). La journée sera ponctuée d’ateliers de danse, de jeux et de cuisine hérités des populations serviles déportées dans l’archipel.