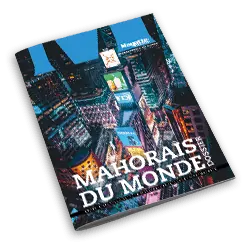Alors que les taximen mahorais ont déjà fort à faire avec les projets de transports interurbains que développe le département, ils doivent aussi faire face à l’essor de la concurrence illégale. Les chauffeurs clandestins, communément nommés « taxis mabawa », ne cherchent pourtant qu’à vivre légalement de leur activité.
Devant la barge, à la sortie du village ou à l’atterrissage à l’aéroport, ils sont là. Bienvenue à Mayotte, où les chauffeurs de taxi ne représentent pas qu’un simple service impersonnel, mais bien une institution quasiment traditionnelle. Taxis-brousse ou taxis-ville, il peut cependant arriver que ces artisans du volant ne soient pas licenciés. Il s’agit des taxis mabawa, surnommés ainsi en référence aux ailes de poulet vendues pour quelques euros dans les brochettis. Qu’ils soient Mahorais, Comoriens, Malgaches ou Africains, tous sont informels, et une partie d’entre eux aimerait obtenir la licence – et parfois même des papiers – pour continuer d’exercer leur profession.
Malgré ces bonnes intentions, les chauffeurs en règle ne peuvent que déplorer cette concurrence illégale. Car, quand le chat n’est pas là, les souris dansent. Pour les lignes de taxi-brousse desservant le sud ou le centre de l’île, ce sont les chauffeurs non-licenciés qui prennent le relai à partir d’une certaine heure. « Après 19 heures, il est rare que des taxis pour Tsingoni ou Combani passent, déclare une habituée, patientant à l’arrêt des taxis centre de Mamoudzou. Donc on n’a plus le choix, il faut bien rentrer chez nous. » Le dimanche après-midi, lorsque les voitures des particuliers emplissent le parking réservé aux professionnels en semaine, de nombreux taxis mabawa se pressent également pour transporter les clients.
Des contrôles trop rares
Karim*, lui, attend la nuit tombée pour sillonner les routes de la commune de Mamoudzou. Chaque nuit, il transporte des dizaines de passagers, de Kawéni à Tsoundzou. Et, à cinq euros le trajet par tête, le chauffeur peut se permettre de prendre des risques. « Moi je dois dire non à des clients, s’étonne-t-il. Il y a beaucoup de gens qui m’appellent, que ce soit des Mahorais ou des mzungus. » Le chauffeur a même abandonné l’idée d’obtenir une licence, qui lui permettrait pourtant de passer outre les contrôles de police. Ces derniers, s’il ne parviennent pas à endiguer le flux de taxis illégaux, sont pourtant déployés sur le territoire. « En 2021, nous avons effectué deux contrôles conjoints police – préfecture sur les points de contrôle d’entrée de la ville, déclare Séverine Lucienne-Bonnotte, cheffe d’état-major à la Direction Territoriale de la Police Nationale (DTPN). C’était une opération spécifique aux taxis. »
Le commandant Lucienne-Bonnotte reconnaît néanmoins que les effectifs de police contrôlent majoritairement les taxis dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine. Environ dix chauffeurs illégaux sont ainsi interpellés tous les mois. « Quand le chauffeur n’a pas ses papiers, il fait l’objet d’une procédure de reconduite à la frontière, explique la cheffe d’état-major à la DTPN. Quand il est titré, puisque c’est souvent le cas, il fait l’objet d’une ordonnance pénale avec une réquisition de 400 euros du parquet. Les voitures sont également saisies et placées sous gardiennage dans les garages. La problématique majeure à laquelle nous devons faire face est que nous n’avons pas de fourrière. » Pour les taxis-motos, la situation est encore plus compliquée. « Ce que l’on sait, c’est que la majorité d’entre eux sont des demandeurs d’asile, continue-t-elle. Les motos sont mises de côté, puisqu’elles n’appartiennent que très rarement aux chauffeurs. Mais il est très compliqué de prouver la complicité du propriétaire, puisqu’il n’existe aucun acte de cession et que les paiements se font en liquide. »
Taxis-motos : « On donne 20 euros par jour au propriétaire du scooter »
Que ce soit sous les bosquets du centre de l’île ou dans la moiteur poussiéreuse de Kawéni, ils pullulent. Il s’agit des taxi-motos, ou taxi-scoots. Maurice*, un Burundais d’une trentaine d’années, est l’un d’eux. Casque accroché entre ses jambes, il balaie les trottoirs du regard, à la recherche de clients. « Mamoudzou, Chirongui, Sada… Je vais partout, s’enjoue le chauffeur. Il n’y a pas beaucoup de routes et donc beaucoup d’embouteillages. Quelqu’un qui sort de la barge et qui doit aller à un rendez-vous est obligé de prendre une moto. » Si Maurice parvient à gagner 50 euros dans un bon jour, il déplore le sort de ses pairs sans autorisation de travail.
« On n’a pas le droit de travailler, alors qu’on paie le loyer, la nourriture, les charges, témoigne-t-il. Beaucoup d’Africains sont obligés de faire taxi-moto, on n’a pas le choix, on doit vivre aussi, nourrir la famille. C’est mieux que d’aller voler les gens, non ? » Dans l’idéal, Maurice aimerait avoir une autorisation de travail, pour « trouver un boulot et me payer la formation de taxi, être comme les autres ». En attendant, il continue ses courses, pris en tenaille par les gardiens de la paix et les propriétaires véreux. « Tous les taxis-motos ne sont pas à nous, des gens achètent des motos et on leur donne 20 euros par jour, selon ce qu’on gagne, déclare-t-il. Et si la police t’attrape, c’est une amende direct, 135 euros mais de ta poche, tu donnes toujours les 20 euros au propriétaire. C’est difficile. »