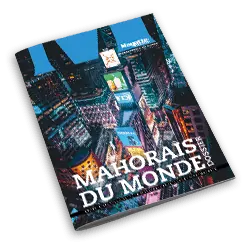Événement emblématique de la lutte contre le cancer du sein, le mois d’Octobre Rose touche déjà à sa fin. L’occasion de mettre en lumière un autre mal, qui touche lui aussi beaucoup de femmes : les violences obstétricales. En donnant naissance à leur enfant, elles sont nombreuses à avoir perdu une part d’elles-mêmes. À porter encore dans leur chair les traces d’un traumatisme qui, dans la plupart des cas, aurait pu être évité. Négligences du personnel médical, manque de suivi, de considération ou de réactivité, les origines de ces violences sont nombreuses, mais souvent tues, entourées de honte et de tabous. Alors, une poignée de Mahoraises ont osé s’exprimer publiquement, raconter comment ce qui devait être le plus beau jour de leur vie est devenu le pire. Et derrière le combat de la libération de la parole, subsiste encore celui de la reconnaissance juridique.
À l’autre bout du fil, les mots de Katia* sont chargés de sanglots. Le souvenir du traumatisme qu’elle a vécu, trois ans plus tôt, est encore vivace dans son esprit. Et pas seulement. Depuis son accouchement, la jeune femme est handicapée physique. En donnant la vie à son fils, la sienne a basculé : depuis ce qui devait être le plus beau jour de sa vie, cette mère, vingtenaire, a perdu l’usage de ses jambes.
Son histoire, Katia peine encore à la raconter. « Mais on doit se battre, ce tabou doit cesser. Aucune femme ne mérite de subir de telles violences. » Alors elle se lance et retrace la trame de son calvaire. Le soir du 20 avril 2017, la jeune femme, alors « en pleine forme », est prise en charge par le CHM. Après une grossesse sereine et sans encombre, elle s’apprête à accoucher de son premier enfant. « C’était censé être un moment merveilleux, magique. Un moment qui serait gravé pour toujours dans ma tête de maman. » Elle se râcle la gorge, aspire une grande bouffée d’air. Comme pour reprendre un peu de courage. « Je n’aurais jamais imaginé qu’un accouchement puisse se passer de cette manière. »
“Cette péridurale, on me l’a imposée”
Lorsque le travail commence, Katia est très claire avec le personnel de santé qui l’entoure : elle ne veut pas d’une péridurale. « La sage-femme stagiaire m’a posé plus de trois fois la question, à chaque fois, j’ai répondu non, je voulais accoucher de manière naturelle. » Quelques heures plus tard, la soignante revient : « Si tu n’acceptes pas cette péridurale, tu ne vas pas accoucher. » Katia ne comprend pas. « On est débordés, me dit-elle, on a beaucoup de femmes dans ton cas, et nous ne sommes pas nombreuses. Alors c’est à toi de décider. » Mais la jeune femme n’aura jamais vraiment le droit de choisir. « Cette dame m’a obligée à dire oui. Cette péridurale, on me l’a imposée sans même m’expliquer pourquoi. »
L’anesthésiste se présente à elle. « Ils m’ont dit de me retourner. » Il pique une première fois, « sans succès ». Une deuxième fois, « non plus ». La troisième ? « Je ne sais pas ce qu’ils ont fait, mais je les ai entendu dire que c’était très compliqué. » Katia s’inquiète, interroge le personnel de santé. « On m’a juste dit de ne pas me retourner. » La peur la gagne, la fatigue, aussi. « Je me suis sentie comme une vache à l’abattoir qui attendait sa fin. » À bout de force, la jeune femme parvient tout de même à accoucher. « Quand mon bébé est venu au monde, les sages-femmes l’ont déposé sur mon ventre puis sont reparties très vite avec lui. Il n’avait pas poussé de cri, tout le monde paniquait. » Katia, elle, se prépare à rentrer en chambre. Mais alors qu’elle tente de se mettre debout, elle s’écroule. Ses pieds ne la portent plus. Sa mère l’aide à se relever, l’accompagne jusqu’à son lit. « Une fois installée, ma mère et la soignante sont sorties de la chambre. Là, elle lui a dit que j’allais rester paralysée. » La raison ? La jeune mère ne la connaîtra pas. Pas même après trois ans d’appel à l’aide lancé auprès de l’hôpital, contre qui elle a décidé d’engager des poursuites. « Je vis dans le noir, dans le sombre. J’ai l’impression de n’avoir aucun droit », explose Katia, en larmes. « Chaque jour, mon enfant me demande quand est-ce que je pourrais marcher comme les autres… »
Depuis, elle a dû quitter son emploi et abandonner sa maison, dont les escaliers lui empêchaient tout accès. Il y a une poignée de mois, Katia s’est rapprochée d’une sage-femme libérale. « Elle m’a expliqué un certain nombre de choses sur mon état, notamment que je devais obligatoirement faire des rééducations. » Ce que l’hôpital n’avait pourtant jamais mentionné. « Aujourd’hui encore, je ressens des douleurs. Il y a des nuits insupportables au niveau de chaque articulation. La douleur me tue, je souffre et j’encaisse ! Ma vie est devenue un calvaire. » Et la reconnaissance de son handicap, sans aucun document du CHM, un chemin de croix.
Les survivantes brisent le silence
Jusqu’à la fin de sa vie, Katia portera en elle les cicatrices de ce traumatisme, dont les stigmates hantent sa vie de femme, de mère et d’épouse jusque dans les moindres détails. Mais en brisant le silence, Katia espère ouvrir une voie et donner le courage de parler à toutes les autres femmes qui, comme elle, ont souffert de négligence, d’un manque d’écoute, de transparence, de considération, le jour où elles s’apprêtaient à donner la vie. Le jour où la leur reposait sur des professionnels de santé. « Les plus gros problèmes viennent de la prise en charge. La plupart du temps, les patientes qui sont là pour accoucher sont confrontées à des personnels trop peu nombreux, qui agissent parfois comme des machines. Mayotte ne doit pas être un terrain d’expérimentation mais j’ai l’impression qu’il faut se battre pour mieux montrer ce que ces situations impliquent. » Ce combat, Katia a depuis décidé d’en faire le sien en libérant la parole.
Il y a cinq mois, elle créait une page Facebook dédiée : « Stop aux violences obstétricales à Mayotte. » Le soir-même, elle compte déjà 50 abonnés. Le lendemain, ils étaient 100. Au total, elle recevra une vingtaine de témoignages. « Lorsqu’on subit ces violences, on a le sentiment de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir se manifester. Nos paroles ne sont jamais prises en compte. Mais nous avons des droits, le droit de dire non, le droit de ne pas accepter ce qu’on nous impose. Ces témoignages sont très importants, ils nous libèrent, d’autant plus que certaines femmes n’osent pas engager de poursuites, par honte d’être jugées ou par peur d’être reconduites, selon les situations. » Sans compter la douleur psychologique de devoir rouvrir de vieilles plaies, de redonner vie à des souvenirs qu’elles voudraient à tout prix effacer. Pourtant, Sandati*, dont Katia a rendu public le témoignage, n’a jamais hésité à mener, elle aussi, ce combat.
À la naissance de son fils, dans un établissement qu’elle craint encore de nommer, son bébé lui est arraché des bras et conduit dans un autre service pour qu’il bénéficie de « soins particuliers », sans plus d’explications. Elle découvrira plus tard que son enfant souffre de séquelles graves, jamais diagnostiquées au cours de sa grossesse, pourtant rigoureusement suivie. « Ce n’est qu’après plusieurs semaines que nous avons appris que notre fils n’aura pas la même chance que les autres, c’est-à-dire aller à l’école, dire ses premiers mots, nous raconter ses journées », égraine douloureusement Sandati.
Là débute un long combat pour faire tenter de déterminer la pathologie du bambin, ses causes, et la possible négligence lors de l’accouchement. Une procédure longue et coûteuse, tant financièrement qu’émotionnellement. « Tout ça nous oblige à revivre cette nuit horrible constamment. Tout ce que nous voulons, c’est comprendre ce qui s’est passé et que si des erreurs ont été commises, elles soient reconnues. Mais cela ne nous enlèvera jamais la tristesse et la rage que nous ressentons envers le système qui nous a volé notre bonheur. » Et les témoignages comme ceux-là sont encore nombreux.
« À mon réveil, on m’annonce la nouvelle : la mort de mon bébé »
Le 17 juillet 2020, Roukia* se présente au dispensaire de M’Ramadoudou à 9 heures du matin pour des pertes de sang, alors que sa grossesse est à son terme. Deux heures d’attente et une prise de sang plus tard, le corps médical lui explique qu’elle présente un bouchon bénin. Qu’elle ne s’inquiète pas, elle peut rentrer chez elle sans danger. En milieu de journée, les premières contractions commencent. Roukia endure la douleur jusqu’à 20 heures. Finalement, son mari la ramène à M’Ramadoudou, où elle ne tardera pas à perdre les eaux. « C’est là que le cauchemar commence. »
La sage-femme détecte une grave anomalie : le cordon ombilical s’est enroulé autour du cou du bébé, l’une de ses mains coincée au-dessus de sa tête. « Prise de panique, elle appelle le CHM qui lui explique que je ne dois surtout pas essayer de pousser, sans quoi le bébé s’étranglerait. Mais pour moi, c’était impossible tant il me donnait des coups de pieds. Je ne pouvais pas me contrôler. » La sage-femme rappelle l’hôpital, mais l’hélicoptère n’est pas disponible, alors qu’une ambulance ne pourra pas être envoyée avant 30 minutes. « L’attente est très longue, je me retrouve avec le bras de la sage-femme à l’intérieur de mon utérus pour essayer de maintenir le bébé en vie. »
Après une attente insupportable, Roukia monte enfin dans le véhicule, direction Mamoudzou, le poing de la soignante toujours nichée dans son intimité. « Elle voulait à tout prix éviter que le bébé arrête de respirer. » Une demi-heure passe, les femmes arrivent au CHM. « On m’a emmenée en salle d’opération, césarienne direct. » L’intervention dure une, voire deux heures. « À mon réveil, on m’annonce la nouvelle : la mort de mon bébé. » Et avec lui, une partie d’elle.
* Noms d’emprunt
« On n’est jamais à l’abri d’une complication »
« Nous avons tout ce qu’il faut dans le service en termes d’équipement, mais l’activité est importante », défend le docteur Madi Abou, chef de pôle gynécologie et obstétrique du CHM. « Aucune structure en France n’accouche autant de bébés que nous avec le même nombre de médecins. D’autant plus qu’en général, ils ne restent pas longtemps, et même si on avait plus de moyens, les recrutements ne sont pas évidents. » Pour le professionnel de santé, cette sur-fréquentation de la maternité, où des femmes accouchent parfois dans les couloirs, couplée à un manque d’effectif, peuvent en effet occasionner des situations exceptionnelles, ou vécues comme telles. « Oui, par manque de temps, nous manquons parfois de communication avec les patients, mais nous n’imposons jamais une décision médicale sans leur consentement ! » En atteste, selon lui, le faible nombre de péridurales pratiquées comparativement aux autres territoires français. « En matière obstétricale, nous ne sommes jamais à l’abri d’une complication, bien qu’elles soient très isolées. Il peut toujours y avoir des problèmes imprévisibles. Nous sommes parfois contraints de sortir un bébé en 20 minutes lorsque sa vie est menacée, et là encore, c’est la communication qui en pâti. » Autre motif de complication, le manque de suivi des grossesses, notamment au moment de la première échographie. « Les premiers mois, beaucoup de femmes cachent leur grossesse, ou ne vont pas consulter parce qu’elles estiment que tout va bien, alors forcément, après, on se rend compte de certains problèmes qu’on n’avait pas vus avant… » Quoi qu’il en soit, Madi Abou assure que son service demeure pleinement disponible aux femmes qui estiment avoir vécu un accouchement traumatisant. Certaines d’entre elles, pourtant, ne sont pas du même avis.
Mayotte Hebdo vise à contribuer au développement harmonieux de Mayotte en informant la population et en créant du lien social. Mayotte Hebdo valorise les acteurs locaux et les initiatives positives dans les domaines culturel, sportif, social et économique et donne la parole à toutes les sensibilités, permettant à chacun de s'exprimer et d'enrichir la compréhension collective. Cette philosophie constitue la raison d'être de Mayotte Hebdo.